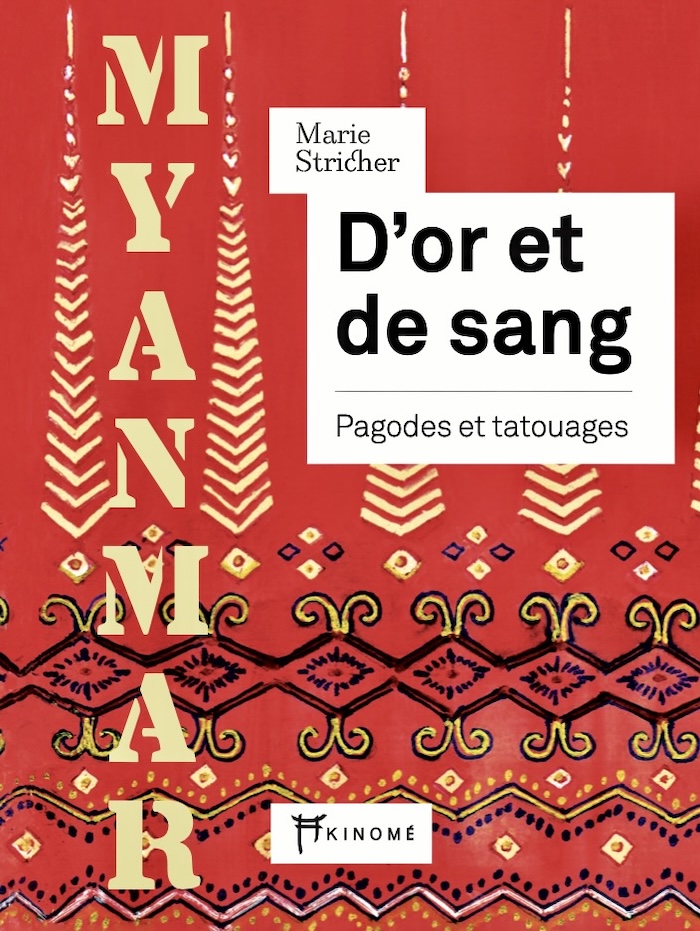
Un nouvel an birman sous le signe des victimes, une chronique de François Guilbert
En cette période de Thingyan que l’on voudrait voir heureuse et pleine d’espérance pour les habitants de la République de l’Union de Birmanie, comment ne pas avoir l’esprit sombre ?
Comment ne pas penser aux centaines de milliers de personnes durement affectées par les conflits armés, l’interminable état d’urgence, les couvre-feux pérennes, la confiscation des libertés, les effets dramatiques des mouvements répétés de la croûte terrestre depuis le 28 mars et les premières inondations de la fin de saison sèche ?
Comment ne pas s’attrister aussi qu’en cette période de Nouvel An bouddhiste, le Conseil d’administration de l’État (SAC) poursuive sans relâche ses opérations de bombardements aériens et terrestres, le plus souvent sur des cibles civiles ?
Gardons le bien à l’esprit ! Depuis que le SAC a proclamé le 2 avril son cessez-le-feu, une centaine d’assauts de la Tatmadaw a été répertoriée sur le territoire.
Près de 300 personnes en ont été meurtries dans leurs chairs. Plus d’une centaine d’individus ont même perdus la vie. Certes, les cessez-le-feu endossés par les parties au conflit semblent devoir être prorogés quelque peu dans le temps, à défaut d’être réellement mis en œuvre sur l’un ou l’autre des fronts à vifs.
Des pressions diplomatiques s’exercent sur le chef de la junte pour qu’ils deviennent des réalités plus tangibles et durables sur toute ou partie du territoire. A l’heure où les secours ont besoin de s’inscrire dans le temps long, il est attendu du numéro 1 de la junte qu’il se montre mieux disposé à offrir la possibilité aux organisations d’assistance humanitaire (inter)nationales d’accéder à toutes les populations dans le besoin. C’est le sens des messages qu’est venu délivrer le premier ministre malaisien au général Min Aung Hlaing le 17 avril à Bangkok.
Cependant, le chef de l’exécutif de Nay Pyi Taw veut, lui, surtout croire que cette démarche de Kuala Lumpur est un début de retour en grâce du régime militaire auprès des chefs d’État et de gouvernement de l’ASEAN. C’est en tout cas un espoir secret depuis que l’ex-premier ministre thaïlandais, Thaksin Shinawatra, a rencontré l’officier putschiste en marge du sommet de la BIMSTEC le 4 avril à Bangkok. Une fois encore la communauté internationale, Thaïlande en tête, fait plus de concessions au SAC que lui n’en consent à ses interlocuteurs étrangers et à sa population. Restons toutefois optimiste en cette heure de Nouvel An !
En attendant de savoir si les manœuvres en cours vont accorder de la légitimité au responsable du pronunciamento de 2021 ou le discréditer plus encore, si on cherche un peu de douceur birmane, on peut se plonger tout entier dans le carnet de voyage de Marie Stricher. Il est vrai que le périple conté s’est déroulé en 2018, autrement dit avant le coup d’État du 1erfévrier 2021 mais qu’à cela ne tienne. Ses chaudes illustrations rappellent combien la Birmanie a pu être et parfois peut être encore un pays où il fait bon vivre et musarder avec des amis.
En passant de Mandalay à l’État Chin, de Bagan au lac Inlé puis Rangoun, l’autrice nous conduit aujourd’hui en des lieux devenus inaccessibles (ex. Mindat, le Mont Victoria, le bar mythique du Strand Hôtel), malmenés par le séisme du 28 mars 2025 (ex. Amarapura, pagode Phaung Daw U) ou désertés par les touristes (Indein). Nostalgie donc mais les moments saisis avec les couleurs de la palette aquarelle donne du baume au cœur.
Alors laissons-nous aller : de la Shwedagon à la rue des bouquinistes de Rangoun, des visages souriants aux portraits d’enfants, de marchés en habitations, de temples en scènes de rues. Des moments saisis sur le vif, souvent avec la complicité, parfois rémunérée, des modèles mais le trait de l’illustratrice dit toute la tendresse qu’elle a recueillie mais qu’elle adresse aussi aux familles rencontrées.
Ses commentaires rédigés ex-post sont pleins d’empathies pour ce que vivent les populations depuis le putsch. Une analyse souvent très à propos même si, ici où là, quelques commentaires approximatifs se sont glissés.
Ainsi, en est-il sur le statut des nombreuses langues vernaculaires, leur enseignement et leur pratique. Il en est de même à propos du bouddhisme présenté comme la religion d’État alors que l’article 361 de la Constitution de 2008 se contente de mentionner que « L’Union reconnaît une position particulière au bouddhisme en tant que foi professée par la grande majorité des citoyens de l’Union ».
Autre à-peu-près, la capitale Nay Pyi Taw a connu ses premiers travaux bien avant la date retenue par l’artiste – voyageuse. N’en goûtons pas moins avec bonheur ce reportage. Il est plein de affection pour le pays et ses résidents, un temps perdu certes mais dont beaucoup espèrent qu’il renaîtra prochainement.
Marie Stricher : D’or et de sang, pagodes et tatouages, Akinomé, Paris, 2023, 111 p, 15,90€
François Guilbert
Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici.












