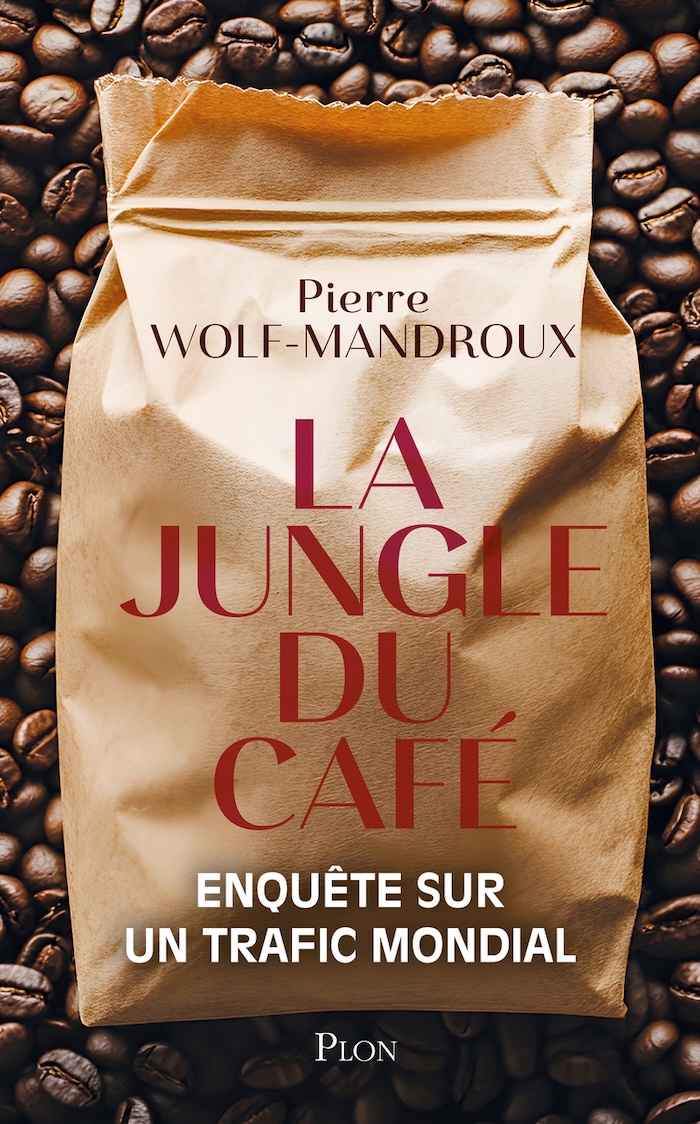
Une formidable enquête sur la culture du Café, une chronique littéraire de François Guilbert
Reporter depuis près d’une décennie au magazine Le Pèlerin, Pierre Wolf-Mandroux vient de passer de longs mois à enquêter sur les dessous de la production mondiale de café. Un travail très documenté, fourmillant d’informations sur les pratiques de culture, les sociétés de négoce et les certifications garantissant des produits bio et/ou éthiques. Une collecte des données loin d’avoir été de tout repos et réalisée aux quatre coins du monde, dans pas moins de quinze pays. Au Brésil et son épicentre du Minas Gerais bien évidemment, premier producteur mondial mais également en Afrique (ex. Éthiopie, Ouganda), en Amérique centrale (ex. Colombie) et en Asie du Sud-Est (Indonésie, Vietnam).
Disons le tout de go : le fond de nos tasses n’est pas très ragoutant. L’exploitation humaine dans les plantations est massive ; virant ici ou là, mais bien plus qu’on ne voudrait le croire voire le savoir, à de l’esclavage. Bien souvent, le minimum minimorum de protection ou de revenus n’est pas garanti. Il n’est pas rare que les ouvriers aient même à payer de leurs poches les outils indispensables à leur travail quotidien.
Quant à leurs conditions de logement et d’hygiènes (ex. accès à des toilettes dignes de ce nom), elles relèvent d’un autre siècle, pour ne pas dire d’un autre millénaire. La situation est si désespérante que la production de café est dans une situation extrêmement singulière. D’un côté, sa consommation mondiale ne cesse de progresser. De l’autre, non seulement la main d’œuvre manque mais elle vie de plus en plus difficilement de son labeur ; et cela aux quatre coins de la planète.
Pierre Wolf-Mandroux exprime cash ses constats
Le journaliste ne se veut pas lanceur d’alertes mais il veut que l’on sache ce que sont réellement les cercles de production de nos kawas. Pour cela, il donne la parole aux exploités, aux agronomes, aux défenseurs des droits humains mais aussi aux coopératives et à des dirigeants de grands groupes industriels. Personne ne manque à l’appel ; le constat n’en est que plus juste et sévère. Industriels ou consommateurs, nous ne voulons vraiment pas savoir ce qui se cache d’abominable dans nos dosettes ou nos percolateurs. Nous nous satisfaisons un peu vite des garanties de bonne pratique autoproclamées par les industriels et certaines organisations dites de la société civile, alors même qu’elles sont extrêmement liées ou émanent des acteurs dominants du marché.
Le sort des agriculteurs n’est pas meilleur chez les nouveaux pays entrant sur le marché mondial que chez ceux qui s’y adonnent depuis des décennies
A ce titre, les informations recueillies sur les hauts plateaux vietnamiens de la province de Da Lak ne sont guère rassurantes. Les hommes et la terre sont maltraités. Des désastres s’annoncent. Certes, le Vietnam a grimpé du 28ème rang mondial à l’heure de la doi moi à la deuxième place du podium international en 1999, en s’y maintenant depuis, mais à quel prix ? Celui de la santé de ses travailleurs et des sols du pays !
L’emploi massif de produits chimiques pendant un quart de siècle met clairement à mal les récoltes futures. Le taux d’échec des replantations est là pour le dire (38%). L’eutrophisation des eaux aussi. Le déclin caféier, s’il se confirme, pourrait bien porter atteintes à d’autres productions, à l’instar de certaines épices (ex. poivre) plantées à côté. Mais au-delà des dommages économiques et naturels, l’enquêteur n’a pas oublié de s’intéresser aux conséquences ethnoculturelles, aux confiscations des rizières et lieux de production sur brûlis.
La culture du café est toute à la fois source d’exploitation, de modernisation et d’acculturation rapide
Ses dommages risquent d’avoir pour conséquence que le pouvoir central à Hanoï cherche à maintenir plus que jamais les curieux loin des régions montagneuses du centre Vietnam et au prix d’une pérennisation des politiques coercitives vis-à-vis des autochtones. Des leçons à méditer, notamment chez les États voisins de l’Asie du Sud-Est continentale. Pierre Wolf-Mandroux le dit en passant puisqu’il n’a pas enquêté à proprement parler en Birmanie, au Cambodge et au Laos.
Du côté de Nay Pyi Taw, par exemple, on se plait en effet à rêver de multiplier par vingt les superficies cultivées. Les conflits armés du moment dans les États Chin et Shan renvoient toutefois aux calendes grecques cette perspective, alors même que la culture du café peut constituer un des éléments de lutte contre la production de stupéfiants en zones rurales isolées du Triangle d’Or.
Reste également à savoir si la Chine et sa province du Yunnan, elles aussi, resteront des pôles de non-production, alors même que la délectation de la République populaire ne cesse de croître (+ 39% de 2019 à 2023). La consommation ayant été multipliée par dix en vingt ans, ni l’État chinois, ni ses entreprises ne peuvent durablement se désintéresser du secteur productif. Ils pourraient d’ailleurs rapidement se positionner sur le segment du trading, le plus rémunérateur et, pour tout dire, le plus stratégique. En attendant, l’Asie du sud-est compte un autre grand nom de la production caféière l’Indonésie. Pierre- Wolf-Mandroux s’est concentré sur son pôle de Sumatra. Il y a déjà de quoi faire, quel qu’aurait été aussi l’intérêt d’ausculter attentivement les plantations de Papouasie occidentale, de Bali ou des Célèbes.
Le café est un facteur de la déforestation massive de l’archipel indonésien
L’Indonésie est le quatrième producteur mondial mais là aussi à quel prix ? Les chaînes de responsabilité sont longues et complexes mais l’une mérite que l’on s’y arrête plus qu’à toute autre, celle des multinationales qui achètent les récoltes. L’analyse de la situation n’est pas proposée par un militant tiersmondiste et des franges anticapitalistes, elle a juste pour objet d’éclairer ceux qui veulent bien savoir ; comprendre de quoi est remplie leur tasse d’arabica ou robusta consommée sur un plan en zinc, au travail ou à la maison.
Une démarche qui fait d’autant plus sens que l’Union européenne a décidé en mai 2023 d’interdire à la vente sur ses territoires des produits issus de la déforestation, dont le café. A ce titre, l’un des chapitres les plus passionnant de l’ouvrage est consacrée aux labels éthiques et certifications de production « durables ».
Une jungle qu’a défrichée avec méthode et méticulosité Pierre Wolf-Mandroux
Une recherche dont le lecteur-consommateur est le grand gagnant. Elle n’est pas sans rappeler celle consacrée voici près d’une décennie par Jean-Baptiste Malet à l’industrie de la tomate (L’Empire de l’or rouge, Fayard, 2017) qui valut le prestigieux prix Albert-Londres au collaborateur du Monde Diplomatique. D’ailleurs, Pierre Wolf-Mandroux assume pleinement cette filiation en décortiquant les pôles de production du café mais aussi en dépeignant les labels AAA de Nespresso, C.A.F.E Practices de Starbucks, 4C auquel Nestlé s’est associé, ou encore ceux de l’ONG Enveritas, Rainforest Alliance, Bird Friendly Coffee. Personne n’en sort véritablement grandi. L’occasion de revenir aussi sur les efforts conduits par les sociétés Max Hevelaar, Malongo, Ethiquable et quelques autres encore.
Dans cet écheveau d’une grande complexité, on voit combien « les consommateurs et les fermiers payent cher des certificateurs pour un résultant qui n’est plus garanti ». La traçabilité est l’exigence que nous devrions donc avoir mais il reste à savoir si cela est possible au-delà de quelques cafés dits de spécialité. Pour s’en assurer demain, on aura besoin, en Asie et ailleurs, de journalistes – investigateurs de la qualité et de la persévérance sur les terrains de Pierre Wolf-Mandroux. Cela demandera à la presse des moyens et parfois aux éditeurs de la détermination car les enjeux politiques, économiques et financiers évoqués sont conséquents.
Pierre Wolf-Mandroux : La jungle du café, enquête sur un trafic mondial, Plon, 2025, 456 p, 23,00 €
François Guilbert
Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici.












