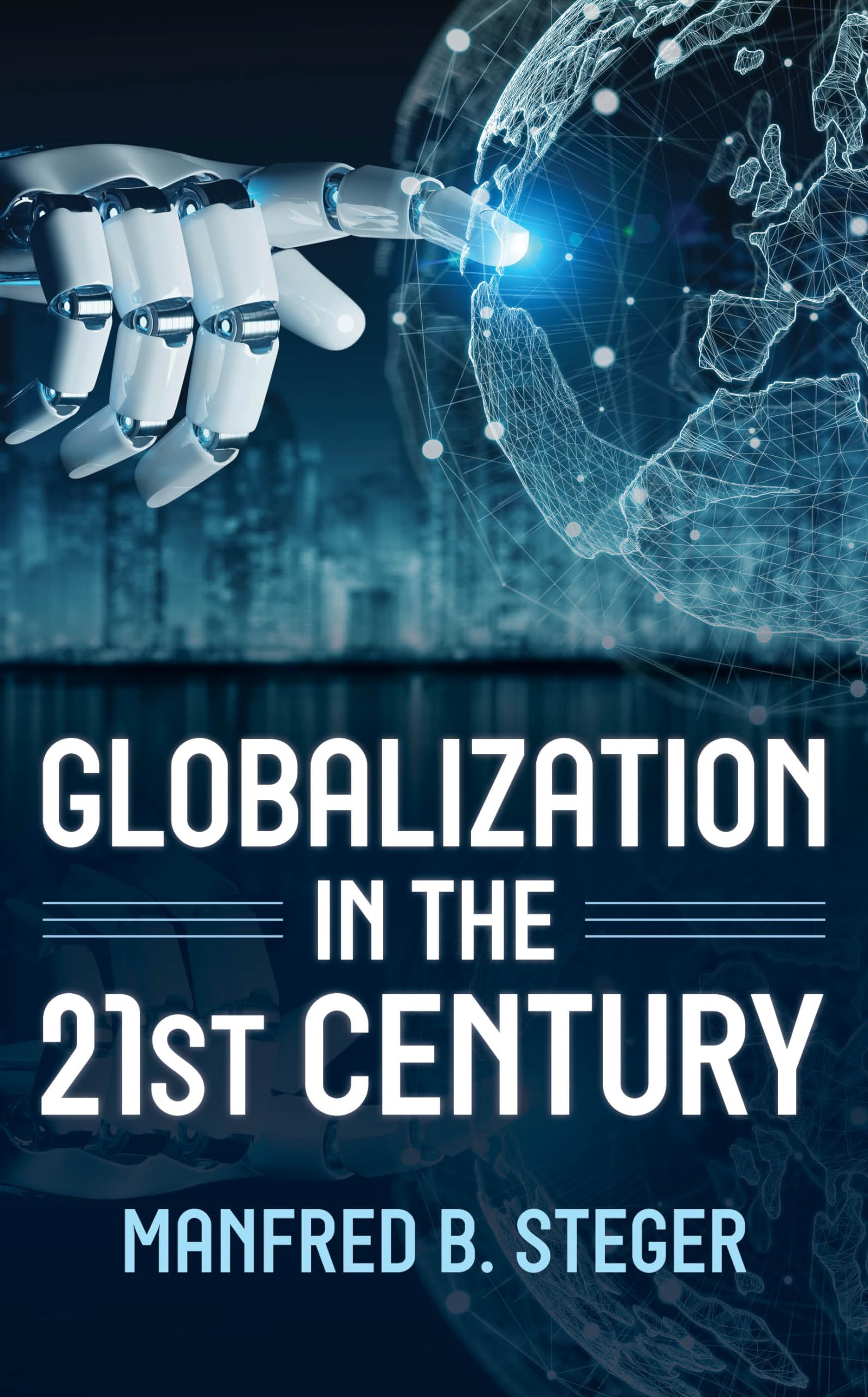
La mondialisation est-elle morte ? Une chronique géopolitique et littéraire de Ioan Voicu
Introduction
En 2025, les médias restent quasi muets sur le processus de mondialisation, le sujet étant éclipsé par de graves crises immédiates – telles que les conflits géopolitiques, les urgences climatiques et les bouleversements technologiques – qui dominent l’attention du public et les agendas médiatiques. Le mot « mondialisation » n’apparaît pas dans le rapport 2025 des Nations Unies sur les Objectifs de développement durable.
Cependant, le débat sur la mondialisation est loin d’être clos. Un ouvrage récent de Manfred B. Steger, intitulé « La mondialisation au XXIe siècle » (Globalization in the 21st century), a l’occasion de le populariser, au moins dans les milieux universitaires. Sa date de publication est le 4 janvier 2024, mais sa parution a également été annoncée pour 2025 par The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., New York et Londres.
Ce volume de 255 pages est superbement documenté et adopte un style lucide, moins sophistiqué. L’auteur de ce volume est professeur de sociologie à l’Université d’Hawaï à Mānoa. Fort d’une solide expérience diplomatique, il a été consultant universitaire sur la mondialisation pour le Département d’État américain. Il est considéré comme un expert des études mondiales, auteur de plus de 30 ouvrages et de nombreux articles sur la mondialisation et les théories sociales et politiques.
Cet ouvrage précieux se compose de trois parties, réparties en huit chapitres, intitulés symboliquement : Partie I : Histoires et théories ; Généalogie de la mondialisation ; Quatre âges de la mondialisation ; Évaluation critique de la théorie de la mondialisation ; Partie II : Idéologies et mouvements ; Mondialisations en conflit ; Le défi du populisme antimondialiste ; Partie III : Enjeux et problèmes ; L’essor des études mondiales dans l’enseignement supérieur ; La mondialisation numérique à l’ère de la COVID-19 ; La mondialisation en 2040.
La préface de l’ouvrage est instructive quant à l’ensemble du son contenu . Elle indique que « le sort de la mondialisation au XXIe siècle est incertain. Bien que des données récentes montrent que la plupart des dynamiques d’intégration mondiale ont rebondi après les effets dévastateurs de la crise financière mondiale de 2008-2009 et de la pandémie de COVID-19 de 2020-2023, l’opinion publique sur la mondialisation reste morose et mitigée. Même certains experts néolibéraux qui ont autrefois présenté la mondialisation comme une « intégration mondiale des marchés bénéficiant à tous » admettent aujourd’hui que leur machine turbocapitaliste est peut-être en train de s’essouffler. En revanche, les visions national-populistes de la démondialisation, agrémentées d’une pointe de « localisme » nostalgique, exercent un attrait considérable auprès des masses. » (p. vii)
Ce n’est pas suffisant. L’auteur est assez prudent et ajoute avec réalisme dans le même contexte que « Le scénario apparent de réaction négative à la mondialisation d’aujourd’hui semble être confirmé par les taux d’inflation en flèche, les faillites bancaires récurrentes, les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, la réaction anti-immigration, l’accélération du changement climatique et de la détérioration écologique, le retard des transitions vers des formes d’énergie plus vertes, l’escalade de la violence politique et la concurrence géopolitique croissante entre les « grandes puissances », en particulier la rivalité entre les États-Unis et la Chine et la longue guerre russo-ukrainienne.
Comme le rapporte le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, le monde subit son plus grand nombre de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec 2 milliards de personnes vivant dans des pays touchés par des conflits et le plus grand nombre de réfugiés jamais enregistré en quête de nouvelles patries. Le Secrétaire général de l’ONU parle à juste titre de multiples crises en cascade et croisées qui alimentent un complexe d’incertitude mondiale jamais vu auparavant dans l’histoire de l’humanité. Après tout, six personnes sur sept dans le monde se sentent en insécurité, une tendance du XXIe siècle qui a été intensifiée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences. Ces personnes sont rongées par le sentiment tenace que le contrôle qu’elles avaient sur leur vie leur échappe. Alors que les normes sociales et les institutions s’effondrent sous l’effet d’une polarisation politique attisée par les réseaux sociaux, ce sentiment croissant d’anomie se reflète dans le constat déprimant que moins de 30 % de la population mondiale estime pouvoir faire confiance à la plupart de ses semblables, la valeur la plus basse jamais enregistrée.
Ce sombre tableau est complété par une constatation formulée en termes personnels concernant un « grand désarroi », qui contient l’affirmation, dans le vocabulaire de l’auteur, que « certains observateurs publics de notre époque du Grand Désarroi (the Great Unsettling) sont même allés jusqu’à suggérer que nous pourrions assister à une répétition du spectre de la Guerre froide, celui d’une annihilation nucléaire totale. » (p. 6)
Contenu inspirant
Le premier chapitre, intitulé « Généalogie de la mondialisation », a le mérite de révéler que « l’explosion discursive soudaine du terme « mondialisation » dans les années 1990 constitue un phénomène extraordinaire, d’autant plus que le terme n’est entré dans les dictionnaires généraux qu’en 1961, dans le Troisième Nouveau Dictionnaire International Merriam-Webster.
Plus d’un demi-siècle plus tard, d’importants dictionnaires et encyclopédies sur la mondialisation, ainsi que des anthologies en plusieurs volumes, ont été publiés, explorant le phénomène dans toute sa complexité. De plus, des milliers d’ouvrages et d’articles ont été écrits sur le sujet, couvrant principalement les dimensions objectives de la mondialisation, telles que les flux économiques transnationaux, les interactions interculturelles et la prolifération des réseaux numériques mondiaux. » (p. 13)
Selon Manfred B. Steger , « la mondialisation désigne la manifestation dynamique du global dans des configurations et des schémas détectables. Nous pouvons élargir ces perspectives étymologiques à une définition de la « mondialisation » comme un ensemble multidimensionnel de processus impliquant l’extension et l’intensification des relations sociales et de la conscience à travers l’espace mondial et dans le temps mondial. » (p. 30)
Lors d’une évaluation critique de la théorie de la mondialisation, l’auteur considère qu’au cours des dernières décennies, « les théories de la mondialisation de toutes sortes ont prospéré. Malgré les discours à la mode sur la démondialisation, cet essor académique suggère que la compression de l’espace et du temps mondial reste un sujet majeur méritant une réflexion approfondie. Parallèlement, cependant, la prolifération des recherches théoriques sur le sujet s’est avérée être une bénédiction mitigée. » (p. 71)
Après avoir examiné les principales théories et approches idéologiques concernant la mondialisation, Manfred B. Steger affirme à juste titre : « Cela ne veut pas dire que nous devrions – ou pourrions – stopper la mondialisation numérique. Pour le meilleur ou pour le pire, les innovations du XXIe siècle dans les technologies numériques – notamment l’IA, la biogénétique, la géo-ingénierie, la bio-ingénierie et les énergies vertes – joueront un rôle décisif dans cet effort collectif visant à réduire les incertitudes liées au Grand Déséquilibre/ Déstabilisant (the Great Unsettling). Mais il ne faut pas oublier que les différentes technologies ne se contentent pas de connecter les gens toujours plus rapidement et sur des réseaux toujours plus vastes. Les distances. Elles peuvent également servir de catalyseurs d’isolement social en substituant les plaisirs désincarnés du monde virtuel aux contacts sociaux en face à face et aux formes directes d’engagement civique et culturel. En effet, l’addiction numérique est devenue une préoccupation croissante, non seulement pour les communautés de joueurs privilégiées du Nord, mais aussi pour ceux qui cherchent à échapper aux conditions désastreuses de leurs mondes en ruine au Sud. (p. 208)
Il y a quelques années, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, envisageait les années 2020 comme une Décennie d’action, au cours de laquelle les acteurs mondiaux et locaux se rassembleraient pour initier et soutenir un changement social transformateur. Si les années et les décennies à venir apporteront de nouvelles crises mondiales et de nouveaux défis, nous ne pouvons plus nous permettre de tergiverser.
Si la gravité des problèmes mondiaux actuels ne doit jamais être minimisée, il serait tout aussi insensé de miser sur l’incapacité de l’humanité à rendre ce monde meilleur. La transition vers un ordre mondial plus juste et plus durable n’est pas une simple possibilité abstraite au XXIe siècle, mais constitue une responsabilité universelle pour les générations présentes et futures. La responsabilité de la viabilité future de notre merveilleuse planète nous incombe à tous. (p. 208)
Manfred B. Steger conclut en soulignant un autre aspect important : « Après les attentats dévastateurs du 11 septembre perpétrés par Al-Qaïda contre les symboles les plus emblématiques d’une économie mondialisée dominée par les États-Unis, cette tendance des mondialistes de marché à tolérer ou à cautionner les tactiques de coercition s’est encore renforcée. Dans un environnement aussi instable et belliqueux, de nombreux dirigeants mondialistes de marché ont estimé n’avoir d’autre choix que de conclure un compromis idéologique précaire avec les faucons de droite.
Ce mariage de raison, difficile et parfois houleux, a marqué la reconfiguration du mondialisme de marché en ce que l’on pourrait appeler un mondialisme impérial à visage américain. Bien que le projet néolibéral n’ait pas pris fin dans les années 2000, la coercition du mondialisme de marché a entraîné une modification de son empreinte idéologique originelle. » (p. 109)
Développant cette idée, Manfred B. Steger affirme : « Il est évident que le monde aurait besoin, plus que jamais, d’une vision fondamentalement différente de ce à quoi pourrait ressembler une planète meilleure. » L’issue ultime d’une impasse prolongée serait peut-être le rétrécissement de la lutte entre les imaginaires national et mondial à une lutte entre deux idéologies opposées : le populisme altermondialiste et le mondialisme de la justice. En définitive, les trois scénarios futurs restent inextricablement liés aux questions d’idéologie politique et de mouvements sociaux : les idées, les valeurs et les croyances sur la mondialisation et les formes d’engagement social qui façonnent nos communautés. Il serait illusoire de croire que le défi populiste altermondialiste s’estompera sans résistance idéologique et sans contestation des mouvements sociaux. Les idées comptent, car elles motivent l’action sociale. Il semble donc certain que la grande lutte idéologique du XXIe siècle ne s’achèvera pas de sitôt. (p. 136)
S’intéressant au champ complexe des études universitaires consacrées au processus de mondialisation, l’auteur espère que « la nécessaire appréciation de l’interaction entre spécialistes universitaires et généralistes doit inclure un respect approprié des contributions cruciales des disciplines conventionnelles à notre compréhension croissante de la mondialisation. Mais le temps est venu pour cette nouvelle discipline de prendre le relais. « L’essor de l’imaginaire mondial n’exige rien de moins de la part des étudiants et des professeurs en études sur la mondialisation, issus de toutes les disciplines et de tous les domaines de recherche. Leurs activités fondamentales d’apprentissage, d’enseignement et de recherche doivent être abordées avec un esprit d’ouverture critique et de cosmopolitisme intégré, digne du monde interconnecté du XXIe siècle. » (p. 162)
Conclusion
Le message final de l’ouvrage dont nous faisons ici la critique est modérément optimiste. Il dit : « nous devons nous laisser guider par l’étoile polaire d’une éthique mondiale de solidarité, de réciprocité, de vérité et de diversité. Si la gravité de nos problèmes mondiaux actuels ne doit jamais être minimisée, il serait tout aussi insensé de miser sur l’incapacité de l’humanité à faire de ce monde un endroit meilleur. La transition vers un ordre mondial plus juste et plus durable n’est pas une simple possibilité abstraite au XXIe siècle, mais constitue une responsabilité universelle pour les générations présentes et futures. La responsabilité de la viabilité future de notre « La merveilleuse planète est entre nos mains à tous.» (p. 208)
Les lecteurs de cet ouvrage n’ont pas manqué de remarquer les fréquentes références à l’importance de la solidarité. Nous n’en reproduisons qu’une, tournée vers l’avenir : « L’humanité est confrontée à la tâche vitale de trouver des alternatives au plus vite, par une action commune dans un esprit de solidarité. » (p. 103)
En cette période de vulnérabilités, de perplexités et de discontinuités mondiales, cet esprit doit prévaloir dans les relations internationales.
En ce qui concerne le concept et la pratique de la mondialisation, nous trouvons approprié de reproduire l’opinion collective du Sommet des BRICS de Rio de Janeiro, qui, le 6 juillet 2025, dans une déclaration commune, a affirmé entre autres que « Nous reconnaissons que la multipolarité peut élargir les opportunités pour les marchés émergents et les pays en développement (EMDC) de développer leur potentiel constructif et de bénéficier d’une mondialisation et d’une coopération économiques universellement bénéfiques, inclusives et équitables. »
Nous nous associons à la recommandation de William I. Robinson, professeur émérite de sociologie à l’Université de Californie à Santa Barbara, qui a écrit : « Voici une étude à succès réalisée par l’un des plus éminents spécialistes mondiaux du passé, du présent et de l’avenir de la mondialisation et des processus politiques, économiques, sociaux et culturels auxquels elle fait référence. Érudit mais accessible, cet ouvrage est appelé à devenir un classique pour les étudiants et les chercheurs du domaine. Au-delà du monde universitaire, il intéressera un public qui cherche à comprendre les questions brûlantes de notre époque. »
En effet, le livre brièvement examiné dans cette chronique représente un aboutissement académique de précieuses contributions à l’élaboration d’une image convaincante de la mondialisation du XXIe siècle qui soutient les efforts pratiques visant à mettre le monde sur une voie plus équitable et plus durable.
Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici.












