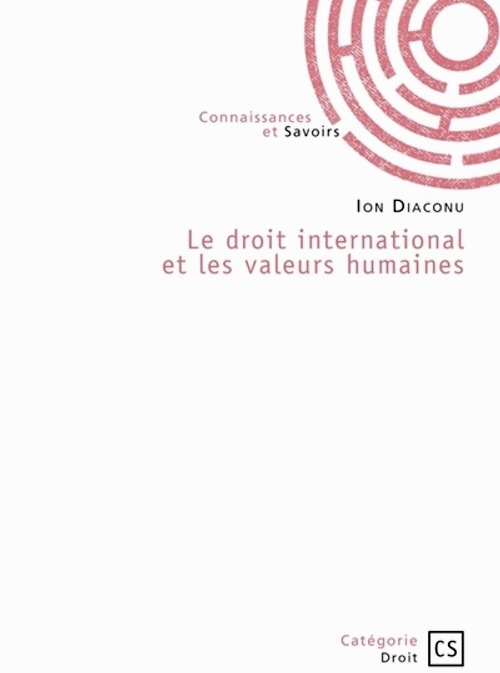
Une chronique géopolitique de Ioan Voicu, ancien ambassadeur de Roumanie en Thaïlande
Le 9 septembre 2025, dans son discours d’ouverture de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, a décrit l’organisation mondiale, forte de ses 193 États membres, comme « un organe mondial de résolution des problèmes, capable non seulement de prévenir des catastrophes comme la guerre, mais aussi de trouver des solutions à d’autres problèmes séculaires qui hantent l’humanité : la pauvreté, la faim, la maladie et les inégalités. Ces efforts, bâtis par le monde pour le monde et fondés sur les valeurs et principes de la Charte des Nations Unies, sont la raison d’être de cette Assemblée. »
Les références aux valeurs et principes invitent les lecteurs à réfléchir à leur rôle actuel dans les relations internationales. La doctrine du droit international est censée clarifier, d’un point de vue juridique et pratique, le contenu et la spécificité réels des valeurs et principes du droit international contemporain. C’est cet objectif significatif qui a inspiré le Dr Ion Diaconu à élaborer une monographie très documentée intitulée Le droit international et les valeurs humaines, ouvrage de 256 pages, publié en 2025 à Paris aux Éditions Connaissances et Savoirs. L’auteur du livre est docteur en sciences politiques de l’Université de Genève, diplomate de carrière, ambassadeur et professeur de droit international public dans plusieurs universités roumaines.
La structure de l’ouvrage est intellectuellement attractive en elle-même et incite à une lecture attentive. Le tableau des matières indique 9 chapitres complets (divisés en une multitude de sections) intitulés, (conformément à l’orthographe du texte original) comme suit : Documents du droit international concernant les valeurs humaines ; Protection du droit à la vie ; La dignité ; La Liberté ; L’égalité ; La Solidarité ; La Justice en tant que Valeur humaine; Respect des droits et des libertés fondamentales de l’homme ; La Paix et la Sécurité Internationales ; Protection de l’environnement et de la nature.
Le volume contient également une brève introduction, une conclusion générale et une bibliographie sélective qui a le mérite de recenser des ouvrages et études roumains récents, peu ou pas connus à l’étranger.
En introduction l’auteur informe ses lecteurs que « La question la plus importante que l’on se pose est de voir s’il y a une relation entre les normes de droit et les valeurs qu’elles affirment, quelle est l’évolution de cette relation dans le temps, si les normes du droit subsistent à protéger ces valeurs et dans quelle mesure d’autres normes étaient nécessaires et si la société offre le cadre et les conditions pour améliorer ou prolonger la protection des valeurs humaines ou le respect de certaines valeurs entrent en conflit avec d’autres ou est mis en danger par des politiques basées sur des conceptions présentées comme des valeurs, mais qui ne sont pas généralement acceptées ou sont contestées sur le plan international. » (p.4)
Pour des raisons d’espace, cette chronique ne peut pas analyser toutes les valeurs humaines sur lesquelles l’auteur propose des développements intéressants, mais elle se concentrera sur la valeur de solidarité présentée de manière plus détaillée dans la monographie et qui a la chance d’être fréquemment citée dans les délibérations de l’AGNU lors de sa 80e session et d’être reflétée dans certains documents de consensus.
Le chapitre V traitant de La Solidarité (pp. 166-184) s’appuie sur des documents récents de l’ONU et des études doctrinales. L’auteur a une approche globalement positive du concept de solidarité, mais en même temps il est réaliste de rappeler expressis verbis que « Des auteurs qui examinent la solidarité dans le contexte de l’Union européenne affirment que « Aussi longtemps que la notion de solidarité universelle n’est pas solidifiée, il faut être conscient des limites et des dangers possibles du discours actuel sur la solidarité.Tout simplement, on ne peut pas ignorer que les manifestations de solidarité peuvent être en même temps non seulement des actes d’inclusion, mais aussi d’exclusion et que le débat pertinent (peut-être de manière paradoxale) porte en lui « le danger de perpétuer même les injustices sociales. « (pp.167-168)
L’ensemble de la monographie illustre l’approche réaliste de son auteur qui estime qu’il faut prêter attention à ceux qui agissent par des moyens politiques, nationaux et internationaux, pour promouvoir le respect des droits de l’homme dans le monde. Il faut aussi analyser les insuffisances du système, ce qui lui manque pour le rendre plus crédible et plus efficace en faveur des hommes qu’il doit servir. Surtout, il faut voir les inégalités qu’il a acceptées et qu’il prolonge en dépit de toutes les critiques, les discriminations qu’il n’a pas réussi à éliminer et les causes de celles-ci. De même, il faut analyser quels sont les moyens dont les États et la communauté internationale disposent pour y remédier. (p.217)
La lucidité, l’excellente documentation, le réalisme, le sens de la vision, ainsi que le style agréable qui caractérisent l’ouvrage que nous avons traité dans cette chronique uniquement du point de vue de la valeur de la solidarité, recommandent le volume signé par le Dr Ion Diaconu, dans son ensemble, pour une large lecture et diffusion.
Au lieu d’une conclusion
Comme le souligne l’auteur, les normes et institutions créées ne sont que des étapes. La liberté reste menacée par la faim, la maladie ou les conflits ; l’égalité, la paix, la solidarité et, plus récemment, la protection de l’environnement demeurent des objectifs à défendre et à promouvoir.
Le plaidoyer humaniste du Dr Ion Diaconu garde en 2025 toute son actualité : derrière les valeurs se trouvent l’histoire de l’humanité et la volonté des peuples de vivre dans la dignité, la liberté et l’égalité. Les résistances persistent, mais les efforts doivent continuer, avec sagesse, détermination et courage.
Les Nations Unies, enfin, sont appelées à montrer la voie, car ses valeurs représentent les grands objectifs universels de notre temps.
Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici.













La Roumanie et quelques autres pays européens ne reconnaissent actuellement et sauf erreur (ce fut en tout cas la situation) aucune existence juridique aux couples homosexuels bien que ces pays soient membres de l’Union européenne et, de ce fait, astreints à l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Membres du Conseil de l’Europe et signataires de la Convention européenne des [droits] de l’Homme, ces États sont censés, avec d’autres pays non membres de l’UE (dont la Russie), respecter le principe de dignité des êtres humains dont la liberté sexuelle est un attribut essentiel (sous réserve de règles limitatives possibles mais compatibles avec l’ordre public). Le droit au mariage, reconnu comme droit fondamental (reconnu en France entre deux personnes de sexe différent et même au profit d’un étranger en situation irrégulière), est reconnu ici et pas là, bien que ces pays prétendent partager un socle commun de droits fondamentaux.
Ces simples constats amènent à se poser quelques questions sur la notion de « valeurs humaines » et celle de « droits fondamentaux » qui ne se recouvrent d’ailleurs pas.
Si l’on va plus loin dans l’examen des droits fondamentaux reconnus dans d’autres espaces géographiques et civilisationnels, la notion de droits fondamentaux semble apparaître comme un oxymore, à moins de la cantonner à ces sphères civilisationnelles avec toutes les déclinaisons possibles, des plus « ouvertes » aux plus fermées.
Si l’on veut bien considérer le même sujet comme celui de la liberté sexuelle, les relations homosexuelles sont interdites, voire criminalisées jusqu’à la peine de mort, dans plusieurs États au nom de droits fondamentaux. Quand ce n’est pas le cas, comme en Roumanie, le mariage homosexuel n’est pas juridiquement reconnu. La déclinaison dans la reconnaissance de ce droit peut apparaître comme atténuée mais ne partage-t-elle pas fondamentalement les mêmes présupposés ? Un « droit naturel » (à l’opposé de toute conception « réaliste ») qui s’appuie ici sur des préceptes de nature religieuse, quelle qu’elle soit, ou supposés anthropologiques, ersatz de positions religieuses non assumées.
Militer pour la reconnaissance et le respect des droits humains est sûrement un objectif, bien que différemment envisagé ; ainsi le combat anticolonialiste fustigea les droits universels au nom desquels l’entreprise coloniale fut menée comme un alibi colonial, aujourd’hui néocolonial et donc une imposture.
Pour reprendre la phrase de Pascal : « Plaisante justice qu’une rivière borne. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », et Joseph de Maistre, dans ses Considérations sur la France (1796), affirmait n’avoir jamais vu d’homme dans le monde. « J’ai vu, disait-il, dans ma vie des Français, des Russes ; je sais même, grâce à Montesquieu, qu’on peut être Persan ; mais quant à l’homme je déclare ne l’avoir rencontré de ma vie ; s’il existe, c’est bien à mon insu ».
PS : La thématique de cette tribune a déjà été abordée à propos du livre de A. Sangiovanni et de J. Viehhoff, dont l’auteur de cette tribune a rendu compte le 17/03/2025 avec mes deux commentaires qui suivent.
Cher lecteur,
Nous avons bien sûr transmis dès réception votre courrier à notre chroniqueur Ioan Voicu. Il va vous répondre. Plaisir de savoir que Gavroche confirme son rôle de plate forme de débat ! La rédaction
Je remercie les lecteurs qui ont pris la peine de réagir à ma chronique publiée dans Gavroche, consacrée à la question : Peut-on encore croire aux Nations Unies ?
Vos remarques, pertinentes et souvent stimulantes, confirment la complexité d’un débat qui dépasse les clivages régionaux, idéologiques ou religieux et qui touche au cœur même de ce que nous entendons par « valeurs universelles » et « droits fondamentaux ».
Pour ma part, je continue à considérer que les repères les plus solides demeurent ceux proclamés dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies du 8 septembre 2000 et réaffirmés en 2005 :
« Nous réaffirmons que nos valeurs fondamentales communes – liberté, égalité, solidarité, tolérance, respect de tous les droits de l’homme, respect de la nature et responsabilité partagée – sont essentielles pour les relations internationales. »
Ces valeurs proclamés par consensus constituent la véritable « grammaire » d’une gouvernance mondiale qui reste encore à construire.
Dans le domaine des droits humains, il faut distinguer principes, valeurs, aspirations et idéaux. Or, la diplomatie multilatérale n’a pas encore réussi à codifier clairement cette distinction. C’est pourquoi la doctrine – académique et juridique – doit poursuivre ses efforts pour éclairer ce champ conceptuel et éviter les confusions souvent instrumentalisées sur la scène politique.
Il est vrai que les interprétations divergent considérablement d’un continent à l’autre, qu’il s’agisse de l’Europe, de l’Asie ou de l’Afrique. L’Amérique latine, en revanche, a montré des avancées exemplaires, notamment dans la reconnaissance des droits des personnes âgées. Mais l’hétérogénéité demeure frappante : au sein même de l’Union européenne, certains États refusent encore de donner une existence juridique aux couples homosexuels, alors qu’ils sont pourtant tenus de respecter la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Je comprends que certains auteurs soient tentés de conclure que « l’Homme universel » n’existe pas. Mais un des rôles des Nations Unies, aussi imparfait soit-il, est précisément de rappeler que derrière la diversité des traditions, il existe une aspiration partagée à la liberté, à la justice et à la solidarité.
C’est pourquoi, plutôt que d’opposer les valeurs dites « occidentales » aux autres, il convient d’encourager un dialogue intercivilisationnel, fondé sur l’écoute mutuelle et la reconnaissance des différences, mais sans abandonner l’idée d’un horizon commun.
Finalement, en réalité, il ne s’agit pas d’« encore croire » ou de « ne plus croire » aux Nations Unies, mais de travailler à les rendre plus crédibles, en renforçant leur capacité normative sur la scène du multilatéralisme.
Ioan Voicu
Je vous remercie pour votre réponse. Le droit international « au futur » ou du futur c’est un peu comme le paradis dans les religions. Il suffit d’y croire au besoin par la contrainte, y compris la plus barbare. À Gaza, pas besoin d’être membre d’un couple homosexuel pour être projeté dans le vide. La « commun[au]té internationale, acteur contradictoire – ballotée par les rapports de forces et pas seulement économiques qui la composent – d’un multilatéralisme à venir, s’apprête à reconnaître un « État » qui non seulement ne remplit pas les critères de la convention de Montevideo du 26 décembre 1933 et l’article 80 de la Charte des NU mais dont les « dirigeants actuels », dont les sondages les plus récents indiquent qu’ils seraient réélus à 75 pour cent, auraient la même position sur la question envisagée et qui, de par leur « charte » encore actuellement revendiquée, aurait pour but la destruction d’Israël.
La perspective d’une évolution positive sur une avancée, certes à construire, un « horizon commun », dites-vous, des « valeurs humaines », me paraît problématique, d’autant que, sur cet exemple, la « position palestinienne » et ses présupposés distillés par l’Iran et le Hamas sont en passe de devenir très répandus dans le monde – y compris et peut-être surtout occidental – et surtout dans les populations les plus jeunes qui, dans un avenir plus ou moins proche, dirigeront les États. C’est donc un État dont les dirigeants affirment consacrer des principes contraires à la Charte des NU que cette organisation me paraît s’apprêter à reconnaître.
Sur le même dossier, une institution comme le Vatican, censée représenter les valeurs humaines universelles (donc catholiques), semble avoir infléchi une position antérieure émise par le précédent Pape au nom même de ces valeurs. Selon Léon XIV, qui vient le réaffirmer « ex cathedra », le « mariage traditionnel » est le seul à pouvoir répondre à une morale fondée sur des valeurs universelles. Cette « Église universelle » « croit » et « travaille » et, dans l’œcuménisme en vogue qu’elle proclame depuis « Vatican II », elle « dialogue », elle « écoute », elle « reconnaît les différences », elle envisage un « horizon commun », mais le sien. Elle n’entend pas !
Même si le doute subsiste quant à l’origine de l’aphorisme, tantôt attribué à Guillaume Ier d’Orange-Nassau ou à Charles de Bourgogne, dit le Téméraire : « Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ». Toutefois, l’absence de réussite et surtout les régressions constatées – que l’ONU actuelle est dans l’incapacité de reconnaître sans même parler de les sanctionner – ne sont pas de nature à envisager un avenir radieux, même à long terme, pour les « valeurs humaines ».
À l’appui des interrogations qui précèdent, on pourra relire l’ouvrage, fustigé lors de sa parution au profit de la thèse de Fukuyama sur la « fin de l’histoire », de Samuel Huntington : Le Choc des civilisations, publié chez O. Jacob en 1997, 387 pages et disponible gratuitement sur Internet.