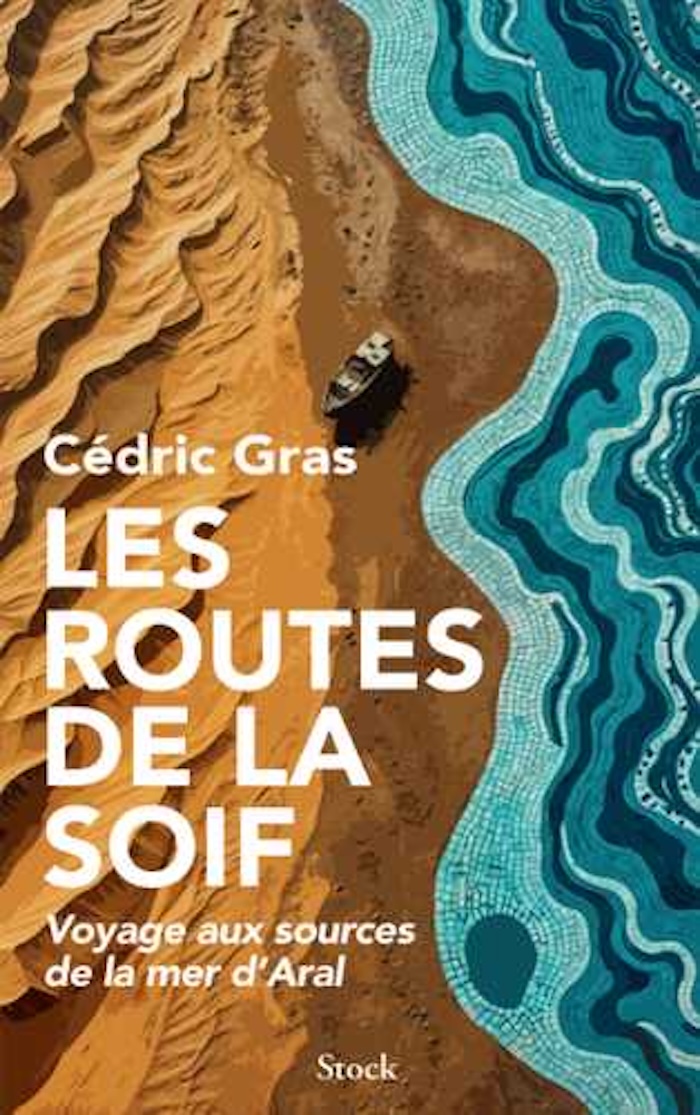
Sur les routes de la soif avec Cédric Gras
Écrivain – voyageur, alpiniste, Cédric Gras sillonne depuis deux décennies déjà l’aire ex-soviétique. Cette fois-ci, direction les sources de l’Amou-Daria avec la conviction que la géopolitique centrasiatique est fondamentalement hydrique, et la possibilité d’une guerre corrélée au débit de l’Amou Daria un scénario des plus plausibles. Mais pour parvenir sur le plateau du Pamir encore faut-il traverser l’Ouzbékistan, le Turkménistan et le Tadjikistan. Un périple aux multiples embûches, celles nées de la géophysique (déserts d’Aral et du Karakoum ; contreforts himalayens), nourries par les événements politiques (cf. l’inaccessibilité de l’Afghanistan) ou des tracasseries administratives de circulation, en particulier au pays de la dynastie des Berdymoukhamedov (Gourbangouly, Serdar) où les étrangers ne sont pas les bienvenus depuis des décennies.
Cette aventure est aussi l’occasion de mesurer l’ampleur de la folklorisation des identités nationales et la (ré)islamisation des sociétés centrasiatiques
Mais pour saisir l’environnement quoi de mieux que s’arrêter dans une tchaïkana. Si on était en Asie du sud-est, on parlerait d’un tea shop. Ici, aussi, on décrypte et refait le monde autour d’une tasse de thé. On peut se délecter sur letapchan d’un peu de kacha (semoule de sarrasin), de laghman (soupe de grosses nouilles), de samsa (feuilletés fourrés), de sazane (carpes), de kishmich (raisins secs), de quelques pastèques et d’un immanquable plov (riz pilaf). On parle de choses et d’autres mais, de plus en plus, du canal de Qosh Tepa annoncé par les Taliban et qui pourrait bien reconfigurer à vaste échelle depuis le nord de l’Afghanistan les disponibilités en eau de toutes les régions en aval. La pax sovietica relève du passé, il faut inventer un nouveau modèle de relations interétatiques entre les cinq nations centrasiatiques. Aujourd’hui, chacun des peuples se plaint des égoïsmes hydriques de ses voisins. Une situation qui n’est pas sans rappeler les mésententes entre les États riverains du Mékong.
D’ailleurs en Asie centrale comme en Asie du sud et du sud-est, les organisations interétatiques chargées de développer les coopérations entre les parties prenantes d’un bassin fluvial s’avèrent peu efficientes. La Commission interétatique pour la coordination de l’eau en Asie centrale n’échappe pas à ce constat. Heureusement néanmoins, on n’en est plus à l’ère où la volonté de détourner le cours d’un fleuve sibérien ou accélérer la fonte des neiges du Pamir s’envisagent à coups d’explosions atomiques (cf. le projet Sibaral).
L’ingénierie environnementale demeure cependant aux goûts du jour
Attention aux stratégies « possibilistes », au génie hydraulique des économistes et des planificateurs développementalistes. L’Asie centrale nous en apprend beaucoup sur les folies constructivistes des hommes, et ô combien les exploitations aquatiques et agricoles irraisonnées pèsent sur l’avenir des sociétés humaines et des territoires. Le coton bien qu’il puisse également servir à la cuisine quotidienne des populations a été et demeure un des facteurs de stress politico-hydriques les plus importants dans toute l’Eurasie.
C. Gras a trouvé le juste ton pour dépeindre avec sensibilité les défis centrasiatiques et les enjeux stratégiques aquatiques et fluviaux globaux, ceux qui agitent tout autant la région du grand Mékong où les inquiétudes suscitées par les velléités de Pékin de détourner une partie du Brahmapoutre pour irriguer la province du Xinjiang. Tourné vers le futur, le narrateur rappelle avec raison qu’il est possible de reconnaître les fleuves comme des entités vivantes pour mieux les protéger, comme cela a été introduit dans le droit indien par le parlement de New Delhi pour le Gange.
En suivant un parcours pédestre et en voiture de plus de 2500 kilomètres, des rives asséchées de la mer d’Aral au plus long glacier de montagne du monde (p.m. le Fedtchenko se dénomme désormais Vanj-Yakh), que d’occasions pour découvrir des cultures singulières et trop méconnues (ex. Haut-Badakhchan, Karakalpak, Ismaéliens, Nizârites..). Les paysages rencontrés sont sublimes comme chacun le sait. Mais la gastronomie locale mérite, elle aussi, d’être appréhendée. Elle est loin d’être uniforme. L’Asie centrale ne constitue pas un bloc. Depuis la nuit des temps, elle est un carrefour, sa culture culinaire s’en ressent.
Cédric Gras : Les routes de la soif, Stock, 2025, 248 p, 20,50 €
Et pour un voyage culinaire à travers l’Asie centrale, lisez les récits de Caroline Eden
La journaliste britannique a publié deux ouvrages de voyage captivants. Red Sands (Hachette Cuisine, 2021, 310 p, 35€) ne se contente pas de rendre compte de ses rencontres gastronomiques dans la région du Kyzylkoum (Sable rouge) mais elle conduit ses lecteurs dans tout l’espace centrasiatique post-soviétique, du Kazakhstan que C. Gras évoque à la marge, aux villages dounganes du Kirghizstan avec de nombreuses recettes illustrées à l’appui.
Les chemins sur les routes de la soif peuvent être goûteux, diversifiés et agrémentés de bonnes tasses de thé noir, vert ou complétés de fruits. Encore faut-il savoir conter les histoires, les rencontres, c’est ce que savent faire avec talent des deux côtés de la manche C. Gras et C. Eden. En évoquant la même région, ils savent parler avec tendresse, humour, du passé et du présent, et plus encore des gens. Ils nous emmènent vers un monde envoûtant, proche et lointain mais toujours plein de saveurs. A ce titre, ne manquez pas de vous plonger avec le même délice dans le premier et le dernier manuscrit de C. Eden : Samarkand (Kyle Books, 2016, 322 p) et Green Mountains (Quadrille, 2025, 288 p), consacré à une randonnée culinaire dans le Caucase.
François Guilbert
Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici.












