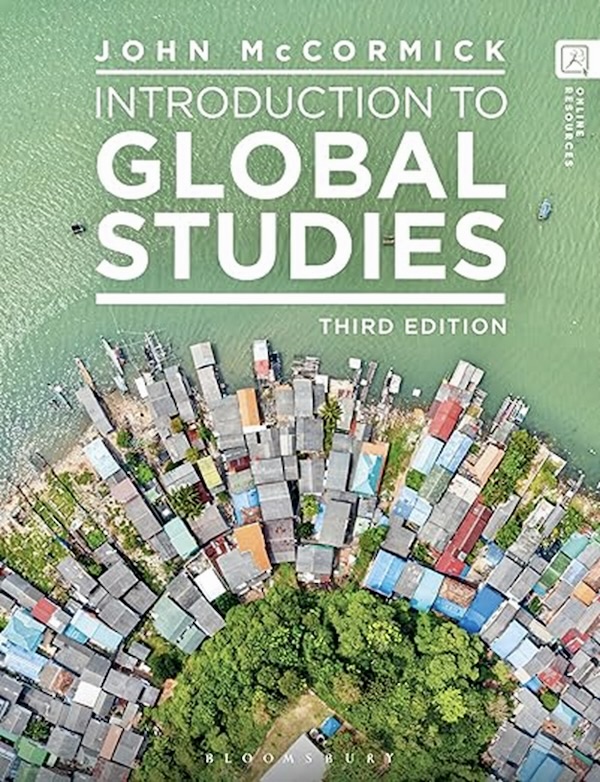
Une chronique signée Ioan Voicu, ancien ambassadeur de Roumanie en Thaïlande, pour éclairer cette devise : « Comprendre l’Asie, c’est élargir les frontières de la pensée mondiale ».
Dans cette chronique, nous nous pencherons sur un ouvrage récent intitulé « Introduction to Global Studies » de John McCormick, publié par Bloomsbury Academic ; 3e édition (6 mars 2025) à New York. L’ouvrage compte 431 pages.
John McCormick est professeur émérite de science politique et ancien titulaire de la chaire Jean Monnet de politique de l’Union européenne à l’Université d’Indiana à Indianapolis (États-Unis). Son ouvrage offre un aperçu complet et accessible des grands enjeux mondiaux qui façonnent le monde contemporain. Destiné principalement aux étudiants novices dans ce domaine, l’ouvrage explore des thèmes centraux tels que les migrations, le commerce, le changement climatique, la santé mondiale, les inégalités et le développement.
La troisième édition comprend un nouveau chapitre sur l’alimentation et l’agriculture et enrichit les chapitres existants avec davantage d’études de cas et de données actualisées, notamment en lien avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Grâce à des cadres comparatifs – comme le Nord et le Sud – et à des articles présentant de multiples perspectives, l’ouvrage encourage la réflexion critique sur l’impact des processus mondiaux sur les réalités locales.
McCormick intègre des points de vue occidentaux et non occidentaux, garantissant une approche équilibrée de la compréhension des interconnexions mondiales. Ce manuel est salué pour sa clarté, son caractère inclusif et son utilité pédagogique, ce qui en fait une ressource précieuse pour les étudiants comme pour les enseignants.
Pour sa pertinence, nous reproduirons une citation significative sur les qualités de cet ouvrage : « C’est le manuel indispensable pour tout étudiant qui commence à explorer les défis et les opportunités mondiaux. McCormick trouve l’équilibre parfait entre une discussion riche et détaillée et un contenu attrayant et accessible, adapté aux étudiants de première année. » ― David Matijasevich, Université Capilano, Canada.
Par études mondiales, John McCormick entend l’étude systématique du système mondial et de ses caractéristiques, qualités, tendances, institutions, processus et problèmes connexes. À la lumière de cette définition, le système mondial désigne l’ensemble des éléments et composantes – personnes, institutions, principes, procédures, normes et habitudes – dont les interactions constituent l’ensemble mondial.
Enfin, la mondialisation désigne le processus par lequel les liens politiques, économiques, sociaux et culturels entre les personnes, les institutions, les États et les gouvernements s’intègrent à l’échelle mondiale.
Pour des raisons d’espace et parce que cette chronique s’adresse en premier lieu aux lecteurs de la revue Gavroche du continent asiatique, nous nous concentrerons de manière sélective sur l’Asie contemporaine, ainsi nommée expressis verbis, sachant que, selon l’auteur, le Sud global est le plus souvent associé à l’Asie, à l’Afrique, au Moyen-Orient et à l’Amérique latine, régions qui comptent certaines des économies les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide au monde (comme l’Argentine, le Brésil, la Chine et Singapour), ce qui soulève la question de savoir combien de temps ces pays continueront à être considérés comme faisant partie du Sud.
Aspects fondamentaux de l’Asie
La première référence directe et substantielle à l’Asie dans son ensemble apparaît dans l’ouvrage sous-jacent, dans un tableau intitulé « Étapes de la croissance du système mondial », qui mentionne les aspects de la mondialisation depuis 1990 : conflit mondial centré sur l’Europe, bipolarité ; conflit idéologique entre superpuissances, multipolarité ; renforcement des liens mondiaux ; essor de l’Asie. (souligné par nous).
Bien que la population mondiale augmente, elle se stabilise au Nord (et même décline dans certains pays), tandis que l’équilibre numérique se déplace vers l’Asie. En effet, la population actuelle de l’Asie s’élève à 4 828 637 196 habitants au vendredi 4 avril 2025, selon les dernières données des Nations Unies élaborées par Worldometer. La population asiatique représente 58,74 % de la population mondiale totale. Grâce principalement aux changements en Inde et en Chine, la plus forte concentration de population humaine se trouve aujourd’hui en Asie de l’Est et du Sud-Est.
En ce qui concerne les mégapoles, dans les années 1950, elles se trouvaient presque toutes au Nord, et seules deux pouvaient être qualifiées de mégapoles : New York et Tokyo, chacune comptant environ 12 millions d’habitants. Aujourd’hui, on en compte 39 – toutes sauf sept au Sud – et on prévoit qu’il y en aura 47 d’ici 2030. Les changements les plus importants ont eu lieu en Asie et en Amérique latine, mais l’Afrique devrait rattraper son retard. Une projection suggère qu’en 2100, les plus grandes villes du monde seront Lagos, au Nigeria, et Kinshasa, en République démocratique du Congo, comptant chacune plus de 80 millions d’habitants. Parallèlement, la plus grande ville actuelle, Tokyo, aura perdu 25 millions d’habitants et sera tombée au 28e rang mondial. Seules deux autres villes du Nord, New York et Los Angeles, figureront encore parmi les 50 meilleures. (p. 51)
On constate également que le vieillissement démographique est plus marqué au Nord. Là-bas, la proportion de la population âgée de 65 ans et plus s’élève actuellement à environ 20 %, contre 10 % en Asie. Le Japon est devenu le pays le plus âgé de l’histoire, avec près de 30 % de sa population âgée de 65 ans ou plus, tandis qu’une grande partie de l’Europe et de certaines régions d’Asie rattrapent leur retard. (p. 56)
L’équilibre devrait toutefois évoluer au cours des prochaines décennies, avec le vieillissement de la population asiatique, notamment en Chine, en Corée du Sud et au Japon, où environ 40 % de la population devrait être âgée de 65 ans ou plus d’ici 2050. (p. 56)
En matière de santé, selon l’Organisation mondiale de la santé (2023), plus de quatre millions de personnes meurent chaque année dans le monde des suites d’une exposition à la pollution atmosphérique, les pires effets étant ressentis en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental, où la croissance urbaine et industrielle a été la plus rapide et où la réglementation a souvent été la plus faible. L’Inde à elle seule compte 13 des 20 villes les plus polluées au monde, Delhi occupant de manière peu enviable la première place. (p. 64)
Dans un contexte historique, l’ouvrage dont il est question ici rappelle que « En 1945, les quatre grandes puissances avaient commencé à être supplantées par un nouveau type de superpuissance capable d’opérer à l’échelle mondiale. Il n’en restait que deux : les États-Unis et l’Union soviétique, dont la puissance était renforcée par la possession de la nouvelle technologie dévastatrice des armes nucléaires. Tandis que d’autres pays (dont la Grande-Bretagne, la France et la Chine) développaient rapidement une capacité nucléaire, l’après-guerre fut marqué par une tension bipolaire entre les États-Unis et leurs alliés, d’une part, et les Soviétiques et leurs alliés, d’autre part. Cette période fut connue sous le nom de Guerre froide, car il n’y avait pas de conflit militaire direct entre les deux principaux protagonistes, mais plutôt une compétition d’influence alimentée par la suspicion, l’hostilité et la méfiance mutuelles, ainsi que par des conflits entre certains de leurs États alliés. » (p. 60)
Avec l’intensification des tensions liées à la Guerre froide, la décolonisation s’est intensifiée, conduisant à la création de dizaines d’États nouvellement indépendants en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Les États émergents du Tiers-Monde, comme on l’appelait alors, observaient avec inquiétude la nouvelle rivalité entre les superpuissances, certains de ses membres étant encouragés ou persuadés de prendre parti pour les Américains ou les Soviétiques, tandis que d’autres tentaient de garder leurs distances.
La guerre nucléaire était découragée par l’idée de destruction mutuelle assurée qu’elle devait inévitablement suivre, et les tensions de la Guerre froide se sont au contraire reflétées dans de nombreux conflits et tensions locaux et régionaux, notamment le blocus de Berlin (1948-1949), la guerre de Corée (1950-1953), la crise des missiles de Cuba (1962), la guerre du Vietnam (du milieu des années 1950 à 1975), le conflit israélo-arabe, les guerres d’indépendance en Afrique et l’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979. (pp. 60-61)
La fin de la Guerre froide en 1989-1990 a non seulement entraîné l’effondrement du bloc communiste en tant qu’acteur distinctif du système mondial, mais a également accentué et accéléré l’émergence de l’Asie et de l’Amérique latine. Le potentiel de pays comme le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Mexique était connu depuis longtemps, mais le renforcement de leur position mondiale devenait désormais plus évident, aidé par la tendance à une plus grande intégration.
Dans le domaine du commerce, l’auteur estime que la nouvelle portée de la Chine est illustrée par l’initiative « la Ceinture et la Route », un projet d’infrastructure massif conçu pour rationaliser les intérêts commerciaux de la Chine à travers l’Asie vers l’Europe et l’Afrique, pour assurer un approvisionnement énergétique stable, pour promouvoir le développement des infrastructures asiatiques et pour consolider l’influence régionale chinoise.
L’objectif ultime est un nouveau réseau commercial centré sur la Chine. Au départ, on craignait que les tensions entre la Chine et les États-Unis ne s’intensifient à mesure que les deux acteurs élargissaient leurs intérêts dans la région, mais la décision de 2017 de l’administration Trump de se retirer du Partenariat transpacifique (un accord commercial entre 12 États signé en 2016) a semblé donner l’initiative à la Chine.
Que s’est-il passé ensuite ? Le lancement rapide en 2020 du Partenariat économique global régional, dont les 15 pays d’Asie-Pacifique formaient le plus grand bloc de libre-échange au monde ; il représente 30 % de la population et de la production économique mondiales. En l’absence des États-Unis, le nouvel accord promettait d’aider la Chine à réduire sa dépendance aux marchés et aux technologies étrangers, et de la positionner plus efficacement pour façonner les règles commerciales de l’Asie du Sud-Est. (p. 236)
Avec clarté, l’ouvrage recensé reconnaît que la science et la recherche scientifique sont de plus en plus mondialisées , et ne sont plus dominées comme autrefois par l’Amérique du Nord et l’Europe ; le centre de gravité de la production mondiale de connaissances se déplace vers l’Asie. (p. 126)
Avant de conclure cette chronique, il est intéressant de noter que la Chine est mentionnée nommément 214 fois dans l’ouvrage, l’Inde 130 fois, le Japon 69 fois et l’Indonésie 18 fois.
Il est regrettable que l’ASEAN ne soit citée qu’une seule fois, et uniquement dans un tableau collectif des organisations d’intégration régionale.
Conclusion
Une bibliographie riche et bien mise à jour accompagne les chapitres du livre, permettant ainsi aux lecteurs d’approfondir leurs recherches sur des sujets incomplètement développés dans cet ouvrage.
Afin de mettre à jour cette chronique, nous nous référons à l’éminent ambassadeur de Pologne et professeur Bogdan J. Góralczyk, signataire de l’étude intitulée « L’Union européenne dans un nouvel ordre mondial émergent », publiée dans la revue universitaire Studia Europejskie – Études sur les affaires européennes, janvier 2025.
Cette étude affirme que « l’actuelle époque est définie dans comme une “ébauche stratégique”, au cours de laquelle la Russie semble déterminée à démanteler l’ordre international, tandis que la Chine cherche à en établir un entièrement nouveau. Nous traversons une période difficile, car l’ancien ordre ne fonctionne plus correctement, tandis que le nouveau n’a pas encore pris forme. » (p. 129)
La même étude souligne également que « alors que nous assistons à une situation sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, tous les grands centres de puissance (dont les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie, le Japon, l’Iran et d’autres) se repositionnent dans un contexte mondial nouveau et dynamique. Pour chacune de ces puissances, il apparaît de plus en plus clairement que l’ordre ancien – qu’il soit bipolaire ou unipolaire – a été rejeté ou gravement affaibli. Le système des Nations Unies, en particulier, est vulnérable et inefficace, car il reflète l’équilibre des forces de 1945 plutôt que celui de 2025. Si le nouvel ordre mondial n’est pas encore pleinement établi, des signes émergents suggèrent qu’il sera multipolaire, et peut-être multiculturel, plutôt qu’européen ou occidentalo-centré, comme au cours des décennies et des siècles précédents.» (p. 148)
Et la toute dernière phrase de l’étude citée affirme : « En cette période de turbulences, la certitude est difficile à atteindre et l’avenir demeure incertain. » (p. 149) Nous pouvons accompagner cette conclusion d’un optimisme modéré. Attendons septembre 2025 pour la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et décryptons attentivement les positions officielles qui seront exprimées par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.
Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici.












