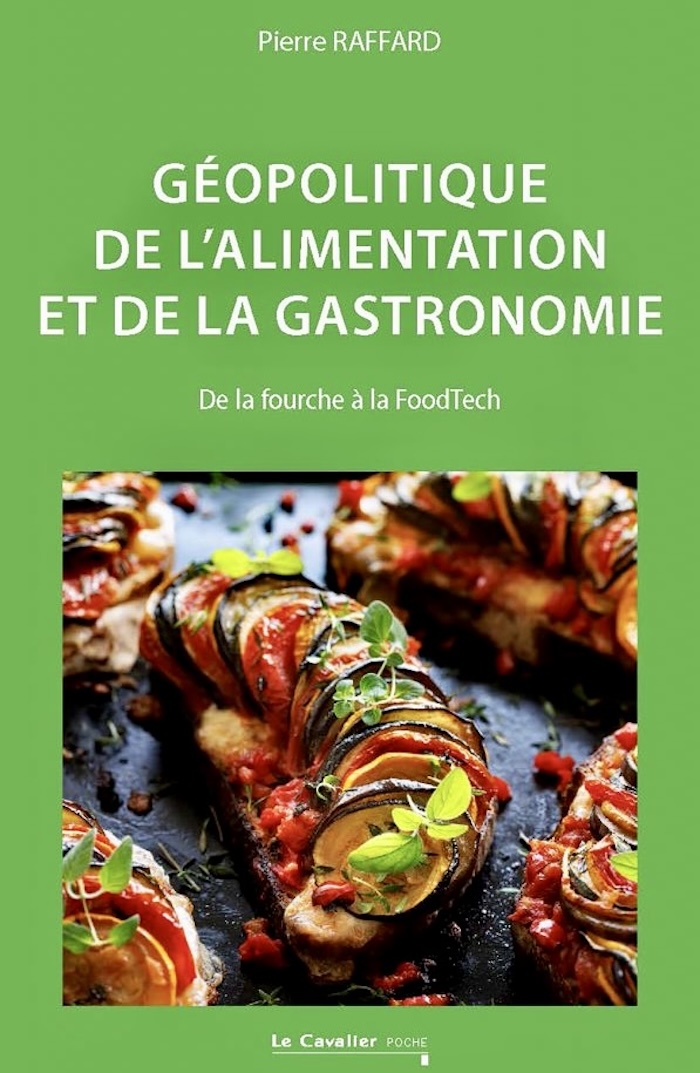
Comment nos assiettes révèlent l’état du monde, une chronique culinaire et sociétale de François Guilbert
Pierre Raffard, le cofondateur du groupe parisien de recherches Food 2.0 Lab, en est intimement convaincu : nos assiettes sont un révélateur de l’état du monde. Alors suivons le ! Premier constat : il est désormais loin le temps où le contenu de nos repas dépendait essentiellement des ressources de proximité. Nos repas et leurs ingrédients se sont peu à peu mondialisés.
Pour comprendre notre alimentation, il faut se faire géo-économiste et géo-politiste
A ce titre, force est de constater que l’Asie s’invite de plus en plus à notre table et à celle de l’appétit des leaders de l’industrie agroalimentaire mondiale. Concentration, financiarisation et uniformisation des modes de production sont tout en haut de l’ordre du jour. La chalendisation globalisée se pérennise et s’accentue. Ce mode développement n’en est pas moins inquiétant. Il a pour corollaire 2 milliards d’humains en surpoids. Mais en parallèle, 820 millions d’autres dont 23 % d’Asiatiques ont des problèmes chroniques d’accès à une alimentation capable de répondre à leurs besoins nutritionnels journaliers. Sortir de ce dilemme n’est pas simple car la nourriture peut s’avérer être une arme.
Depuis le milieu des années 70, l’arme alimentaire est redevenue d’un emploi courant
Si la junte du général Min Aung Hlaing y recourt régulièrement, comme nous le voyons dans les colonnes de Gavroche, notamment en cette période post-séisme de Mandalay, elle n’est pas seulement un élément de coercition dans les guerres civiles. La guerre d’Ukraine nous a même rappelé l’effet systémique que peut avoir ce type de confrontation. Néanmoins, et ne l’oublions pas, son usage courant a convaincu humanistes et juristes d’en faire un élément constituant d’un crime guerre au regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (article 8, alinéa 25).
Pour autant, l’arsenalisation de l’alimentation n’est pas seulement le fait des États. Exemples à l’appui, P. Raffard montre que les boycotts de produits sont aussi l’apanage des sociétés civiles. Les appels à la mise à l’index sont monnaie courante dans les conflits (inter)nationaux. Mais au-delà de tous les constats confrontationnels, l’auteur s’est intéressé aux marchés des ressources foncières agricoles où acteurs économiques chinois et indiens sont très actifs et développent des emprises durables sur de vastes terroirs. Toutefois, l’alimentation et ses ingrédients ne sont pas seulement des facteurs de puissance, ils constituent des éléments d’attraction (trans)nationaux majeurs.
L’assiette est aussi une arme de séduction massive
Comme le rappelle avec malice le narrateur, cela peut susciter de vives controverses. Dans le Pacifique, Australiens et Néo-Zélandais se déchirent à pleines dents sur la paternité d’un dessert : la pavlova. Les controverses gastro-diplomatiques n’opposent d’ailleurs pas seulement des États limitrophes. Il en va ainsi depuis des années des débats sino-ivoiriens sur la semoule de manioc attiéké. Héritage patrimonial et intérêts commerciaux ne font manifestement pas très bon ménage.
Les batailles autour d’un plat peuvent aussi cacher des confrontations idéologisées. Le kebab est devenu en plusieurs points d’Europe un terrain d’affrontements politiques emblématiques, aussi inattendu qu’incongru. Si à n’en pas douter certains plats sont piégeux, il n’en existe pas moins un soft power culinaire que de nombreux États ont appris à maîtriser. Dans ce livre, la comparaison Chine – Japon illustre très bien cette réalité. Plus que tout autre puissance, le Japon a réussi à valoriser sa culture, ses mœurs et ses valeurs au travers de sa cuisine. Des plats « icônes » (ex. sushi, tempura, yakitori), des techniques de préparation singulières (ex. tataki, teryaki) et des certificats de bonne pratique délivrés avec sérieux à des établissements à l’étranger sont devenus des instruments promotionnels sans égal. Paris compte ainsi 765 restaurants « japonais » pour 420 « chinois ».
Dans sa description des « branding » d’État, P. Raffard est revenu assez longuement sur les efforts de Bangkok et Séoul entrepris depuis ces vingt dernières années. Il a dépeint avec forts détails les campagnes engagées (cf. Global Thai, Thailand : Kitchen of the World, Thailand’s Brand), les labels d’excellence et d’authenticité, les succès enregistrés et les mimétismes suscités à l’échelle aseanienne (ex. Indonésie, Malaisie) auxquels il convient d’ajouter le Cambodge mais aussi leurs effets sur les politiques touristiques. Avec plus ou moins de fracas, de nouveaux courants d’échanges se bâtissent sous nos yeux et avec nos papilles.
Nos assiettes se métissent
Les cultures culinaires s’hybrident. A titre d’exemples, P. Raffard s’est intéressé à l’effervescence boulangère en Asie et à l’un de ses pendants la boulangerie-pâtisserie asiatique « à la française ». S’il démontre combien l’Asie a su trouver sa place voire même conquérir une position éminente, il l’oppose au rang plus périphérique qu’occupe encore l’Afrique dans ce processus de mondialisation. Les pages qu’il consacre au monde sub-saharien, aux spécificités de la restauration africaine, à quelques chefs emblématiques, à la lente émergence d’enseignes de fast-food dans l’hexagone (ex Afrik’n’Fusion, Osè African Cuisine, Tombouctou Fast Food) ou encore aux plats régionaux préparés pour la grande distribution (cf. Tomba), ce sont les nombreux efforts de rattrapage en cours dont il cherche à nous faire prendre conscience. Cependant, l’écart d’attractivité continentale est encore considérable. Néanmoins, cuisines asiatiques et africaines font assaut de communication. Un enrichissement gustatif à n’en pas douter mais aussi visuel, tant nos repas ont pris l’habitude d’être « instagramable ». Une tendance forte mais qui pourrait bien rapidement s’accompagner d’une nouvelle évolution majeure avec la révolution de la FoodTech à laquelle de nombreux industriels asiatiques concourent (ex. Brésil, Chine, Corée, Inde, Indonésie, Japon, Singapour, Taïwan). A suivre avec la plus grande attention pour mieux comprendre ce que vont devenir, dans les années qui viennent, nos assiettes euro-asiatiques !
Pierre Raffard : Géopolitique de l’alimentation et de la gastronomie, Le Cavalier Bleu Éditions, 2025, 174 p, 13€
François Guilbert
Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici.












