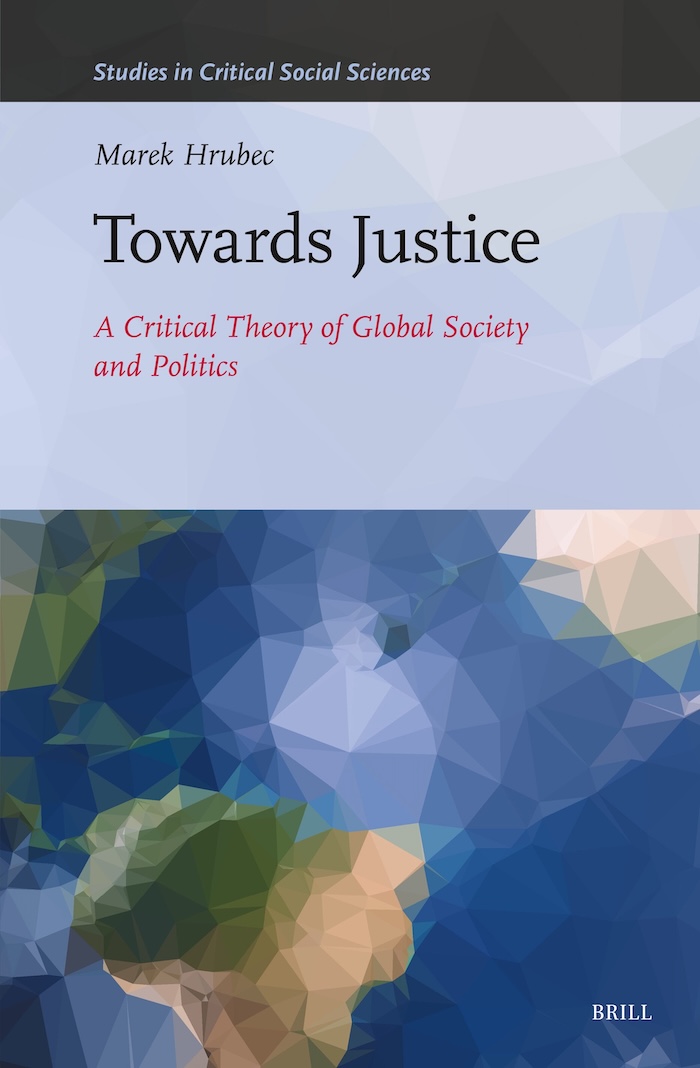
Une chronique géopolitique de Ioan Voicu, ancien Ambassadeur de Roumanie en Thaïlande
Au moment où se réunit à New York l’Assemblée générale de l’ONU…
Le 80e anniversaire des Nations Unies est l’occasion idéale de réfléchir à la contribution de la doctrine à la familiarisation des 193 États membres de l’organisation mondiale avec les valeurs et les principes d’une institution qui en 2025 n’est pas au meilleur de sa forme politique, juridique et morale, malgré les efforts de la majorité de ses membres pour la revitaliser et accroître son rôle dans la résolution des problèmes mondiaux.
Afin d’éviter toute interprétation erronée du sens de la doctrine, il convient de préciser que nous lui attribuons uniquement le sens que lui reconnaît le Statut de la Cour internationale de Justice, qui dispose en son article 38 : « La Cour, dont la fonction est de trancher conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique (…) sous réserve des dispositions de l’article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyens subsidiaires de détermination des règles de droit. »
Il convient également de souligner que le Statut de la Cour internationale de Justice est considéré comme partie intégrante de la Charte des Nations Unies, instrument juridique fondamental dans le domaine du droit international public.
C’est dans ce contexte qu’il convient de situer l’ouvrage intitulé « Vers la justice Une théorie critique de la société et de la politique mondiales » (Towards Justice A Critical Theory of Global Society and Politics), signé par Marek Hrubec et publié en 2025 à Leyde et Boston par Brill,une maison d’édition spécialisée en diplomatie et en droit.
L’auteur de ce récent ouvrage (364 pages), Marek Hrubec est un philosophe social et politique, expert en études mondiales. Ses recherches portent sur la critique sociale, la justice sociale et politique et l’égalité dans les contextes mondiaux, en particulier dans les pays du Sud. Depuis 2021, il dirige le département de philosophie morale et politique de l’Institut de philosophie de l’Académie tchèque des sciences. Il a donné des conférences et mené des recherches dans l’Union européenne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, en Chine, en Uruguay, au Kazakhstan, en Inde, au Burundi, au Nigeria, en Éthiopie, etc.
Dans l’introduction de l’ouvrage analysé dans cette courte chronique, Marek Hrubec informe les lecteurs que « cet ouvrage aborde les questions théoriques de l'(in)justice sous différents angles territoriaux et temporels. Il examine la société et la politique dans un contexte européen et, plus généralement, occidental, ainsi que dans le contexte des pays du Sud et des interactions mondiales. Il analyse le sujet principalement au cours des dernières décennies, dans le cadre plus large des siècles de modernité, mais l’aborde également en partie dans le contexte du développement civilisationnel à long terme. » (p. 1)
C’est en raison des hautes qualifications académiques de l’auteur que les lecteurs devront consulter l’ouvrage mentionné ci-dessus et demander à Marek Hrubec comment il voit les Nations Unies en 2025.En qualifiant les valeurs de principes fondamentaux des Nations Unies, l’on en revient à leur conférer par la doctrine une fonction ordonnatrice. Dit autrement, elles servent à décrire l’architecture du droit international et à y identifier les structures et institutions sur lesquels il repose.
L’auteur rappelle d’abord qu’« après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays ont revitalisé le droit international, créé les Nations Unies et rédigé et adopté d’importants documents juridiques. Cependant, les aspirations initiales les plus ambitieuses n’ont pas été satisfaites en raison de la Guerre froide. Là où les espoirs subsistaient, ils se sont transformés en pure utopie. » (p. 4)
L’une des premières références explicites de l’auteur à l’organisation mondiale est la suivante : « La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a adopté l’Accord de Paris par 195 États en 2015 ; cet accord incluait l’objectif de poursuivre une approche mondiale face à la menace du changement climatique… Le présupposé était qu’une telle transformation permettrait aux sociétés de se développer sans changements négatifs majeurs. En 2018, cependant, le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur le réchauffement climatique a souligné que le changement climatique mondial serait un problème bien plus grave que prévu. » Le GIEC a déclaré que l’humanité devait réagir avant 2030, faute de quoi des changements dramatiques étaient à prévoir, comme l’inondation de vastes territoires. (pp. 87-88)
Des exemples pertinents sont fournis dans des domaines très variés. Dans l’esprit de la Charte des Nations Unies (article 56) et de la Déclaration de Rome du Sommet mondial de l’alimentation, chaque État a l’obligation internationale de reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale et de respecter son engagement d’agir, conjointement et séparément, pour assurer la pleine réalisation du droit à une alimentation adéquate. Dans le cadre de cet engagement, les États parties devraient prendre des mesures pour respecter l’exercice du droit à l’alimentation dans d’autres pays, protéger ce droit, faciliter l’accès à l’alimentation et fournir l’aide nécessaire en cas de besoin.
Une question d’actualité essentielle est présentée aux lecteurs : « On peut se demander s’il existe des raisons de croire que l’humanité évoluera différemment que par le passé et évitera indéfiniment les conflits armés. Avec la technologie actuelle, cela signifierait non seulement des guerres territoriales limitées, mais aussi des conflits militaires à l’échelle mondiale. Y a-t-il des raisons de penser que les Nations Unies peuvent empêcher un autre conflit mondial. » ?
Si l’on fait abstraction du scénario de guerre du pire, on peut également se demander s’il existe des raisons pour lesquelles l’humanité, à l’échelle mondiale, ne devrait pas s’enliser dans l’homogénéisation et l’autoritarisme face à des scénarios positifs. Il est difficile de répondre à ces questions et d’en fournir des arguments convaincants. Mais comme pour notre approche du développement technologique négatif, cela ne doit pas signifier abandonner la recherche ou les tentatives de prévenir les scénarios négatifs, ou du moins d’en réduire l’impact. Même un petit espoir reste un espoir.» (p. 307)
C’est dans ce contexte que l’auteur examine la valeur de la solidarité. Dès le début, il écrit : « Le principe de différence sociale est aussi la reconnaissance des personnes dans des situations qui s’apparentent à une justice sociale spécifique (malades, chômeurs, etc.), mais, dans ce cas, il s’agit de reconnaître des personnes dans des situations qui ne correspondent pas à leurs besoins fondamentaux. La légitimité de l’inégalité de statut des personnes, c’est-à-dire le bien-être des uns et la précarité des autres, est également remise en question par les conflits sociaux qui affectent non seulement les plus démunis, mais aussi les plus aisés, en raison des tensions et des dysfonctionnements de la société. Ce principe, qui contribue à l’élimination des inégalités sociales, est le concept de solidarité avec les plus défavorisés. » (p. 314)
Abordant la question de la solidarité politique et culturelle, Marek Hrubec estime que « un autre principe de différence dans la sphère culturelle et politique est l’équité, analogue au principe de solidarité sociale. Il ne s’agit pas de répondre aux besoins fondamentaux de survie ou, au mieux, de simple subsistance de groupes de personnes culturellement et ethniquement définis… mais de réduire les inégalités les plus profondes.
Par exemple, soutenir des projets culturels (magazines, festivals, théâtres, etc.) de différents groupes de personnes culturellement et ethniquement définis afin de les développer dans le contexte d’autres modèles culturels dominants permet de revitaliser et de renforcer les activités culturelles de groupes de personnes jusqu’alors défavorisés qui peuvent avoir des difficultés à survivre dans l’environnement de la culture dominante. Dans la sphère politique, la discrimination positive envers les personnes issues de groupes minoritaires défavorisés lors des élections à divers conseils peut être un cas similaire, mais cette fois-ci non pas en termes de reconnaissance fondamentale… mais en termes de solidarité qui vise une justice plus large. » (p. 316)
Dans la dernière page de la partie substantielle de l’ouvrage, Marek Hubec émet la prédiction suivante : « Les conflits et les guerres régionales, voire une guerre mondiale, peuvent conduire à l’instauration d’une dictature mondiale, dont l’élimination et le remplacement par une justice mondiale nécessiteraient à l’avenir une théorie de la justice sociale mondiale capable d’offrir à la fois une critique et une explication de la situation, ainsi qu’un calendrier normatif pour le développement ultérieur.» (p. 322)
Il convient d’ajouter que cet ouvrage bénéficie d’une excellente bibliographie actualisée, où les documents de l’ONU occupent une large place, et d’un index détaillé qui aidera le lecteur à repérer toute notion significative présente dans cette recherche.
Pour les lecteurs qui souhaiteraient résumer en quelques mots le contenu de ce livre, la réponse pourrait être la suivante : s’appuyant sur une critique des contradictions libérales et libertaires et de leurs conséquences conflictuelles, ainsi que sur des analyses de théories et perspectives sociales critiques du Sud (Amérique latine, Afrique et Asie) et du Nord, le livre qui a inspiré notre courte chronique cherche à aborder les tensions liées à la méconnaissance et à l’injustice sociales mondiales. Il traite du conflit autour des normes particulières et universelles aux niveaux local, régional et mondial, de la reconnaissance sociale extraterritoriale des pauvres du monde, du socialisme stratégique, des menaces d’hégémonie mondiale, de l’autoritarisme et de la guerre à la lumière de divers conflits.
Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici.













Comme souvent, les chroniques de M. Voicu, ici un compte rendu d’ouvrage, amènent à réfléchir et à préciser :
À la lecture de la chronique et sans avoir lu l’ouvrage cité (en anglais d’ailleurs et auquel il est difficile de se référer sans parler de sa lecture par un francophone), la réflexion suggérée me semble plutôt aborder des questions morales que juridiques. L’auteur de l’ouvrage cité ne semble d’ailleurs pas être juriste.
La chronique part du constat du changement des paradigmes ayant été à l’origine du système institutionnel onusien de l’origine. La guerre froide qui s’installe à partir de la guerre de Corée aurait perturbé et entravé le système imaginé en 1945. L’avènement de très nombreux États devenus indépendants va modifier les rapports de force et les stratégies d’influence au sein de l’Assemblée générale des N.U. et entraîner des paralysies du Conseil de sécurité par usage du droit de véto pour les actes et actions relatifs aux mesures préventives ou coercitives relatives à la paix dont l’égalité entre les peuples et les individus est une des composantes. La notion de solidarité peut être analysée comme une déclinaison, in concreto, de la notion abstraite d’égalité.
Il semble que nous assistions actuellement à un approfondissement des mêmes éléments de fragmentation à l’œuvre, radicalisés par la volonté de la Russie et de la Chine, s’appuyant sur les pays anciennement colonisés – ou non – (les pays dits du Sud global), de modifier les rapports de force et les zones d’influence et, à terme, de modifier l’architecture institutionnelle onusienne et le droit international qui pourrait en découler.
Dans le cadre d’institutions à vocation internationale et donc à but universel, la notion d’humanité est centrale. Celle-ci est supposée reposer sur des valeurs que la Charte et le statut de la Cour internationale de justice (article 38), à propos des principes généraux du droit pouvant être une source du droit international, réservaient, dans une formulation qui subsiste toujours, aux « nations civilisées ». La formulation, quelque peu problématique au regard de l’unité que représente l’humanité, semble avoir disparu des références et être devenue caduque.
La notion de principes fondamentaux est commune au droit interne et au droit international. Son contenu est l’objet d’une élaboration continue dans le cadre de l’activité du juge ou de l’arbitre. Elle consiste, par un travail d’interprétation, à « extraire » – comme l’or de la mine – des règles en vigueur (y compris des principes fondamentaux déjà reconnus) des principes qui seront érigés comme ayant une valeur juridique. Ces règles pourront ensuite irriguer les dispositifs normatifs dont l’ONU aura décidé de s’emparer. L’environnement et le climat sont, de ce fait, un terrain majeur d’intervention puisqu’ils concernent l’« Humanité » dans sa survie même. La question de l’alimentation, au moins dans sa dimension vitale, entre dans la même catégorie. Elle peut être déclinée, par approfondissements successifs, en alimentation suffisante puis, au regard de préoccupations sanitaires, une alimentation saine, etc.
Pour ce qui est des droits dont la composante est nettement civilisationnelle (même si la lutte contre les défis climatiques peut rencontrer des obstacles civilisationnels plus ou moins locaux), l’accord général est plus compliqué à définir et à atteindre. La réduction des inégalités économiques, souvent supposées – un présupposé partagé – réduire les « écarts civilisationnels », est susceptible d’appréciations variées, si ce n’est divergentes. La mondialisation des échanges à laquelle nous avons assisté depuis 1980 n’a pas réduit les inégalités, au contraire. A-t-elle réduit, mécaniquement, les écarts civilisationnels ? On peut en douter… Y a-t-il même une relation entre les deux ordres ?
La notion d’équité (juger « ex aequo et bono », prévu à l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice) évoquée est une vieille réponse du droit romain attribuée à Cicéron (De officiis), « summum jus, summa injuria ». Il s’agit d’un principe que le juge peut être autorisé à mettre en œuvre, si les parties au litige l’ont autorisé, pour écarter la règle si son application conduit à une injustice manifeste (dont l’étendue doit être préalablement circonscrite) ou en cas d’absence de règle.
Quant à la doctrine, somme des commentaires de juristes (au sens large), elle n’est qu’une source subsidiaire, comme la coutume, du droit international pour autant qu’elle ne contrevienne pas aux règles.
On pourra par exemple se reporter à l’ouvrage de Monique Chemillier-Gendreau, Humanité et souverainetés. Essai sur la fonction du droit international, publié aux éditions de « La Découverte » en 1995, 382 pages.
Cher lecteur, nous avons transmis votre message à notre chroniqueur Ioan Voicu qui va bien sûr vous répondre. Bien cordialement, la rédaction.
Je remercie vivement les lecteurs pour l’attention portée à ma chronique et pour les commentaires qu’elle a suscités. Permettez-moi de préciser, tout d’abord, que je n’ai pas vocation à répondre au nom de l’auteur de l’ouvrage Vers la justice. Une théorie critique de la société et de la politique mondiales (Towards Justice. A Critical Theory of Global Society and Politics), signé par Marek Hrubec. Ma contribution se limitait à une brève chronique de présentation et de réflexion sur ce livre.
C’est pourquoi je considère les remarques formulées à la suite de ma chronique comme des compléments précieux, qui prolongent utilement la discussion. Elles ouvrent, en effet, des perspectives d’analyse que je n’ai pu qu’esquisser.
Je partage l’idée, soulignée dans le commentaire, selon laquelle la solidarité peut être comprise comme une déclinaison concrète du principe d’égalité. Ce lien étroit entre solidarité et égalité n’est pas fortuit : il est affirmé de manière explicite dans la Déclaration du Millénaire adoptée le 8 septembre 2000 par consensus à l’Assemblée générale des Nations Unies, où la solidarité figure immédiatement après la liberté et l’égalité parmi les valeurs fondamentales.
Je tiens aussi à exprimer ma gratitude pour le rappel de l’ouvrage de Monique Chemillier-Gendreau, Humanité et souverainetés. Essai sur la fonction du droit international, que je me propose de consulter avec le plus grand intérêt.
Ces échanges montrent, s’il en était besoin, que la lecture d’un ouvrage ou d’une chronique ne constitue pas une fin en soi, mais le point de départ d’un dialogue intellectuel toujours perfectible, dans lequel chacun contribue, par ses remarques et références, à nourrir la réflexion commune.
Avec mes remerciements renouvelés et mes sentiments cordiaux,
Ioan Voicu