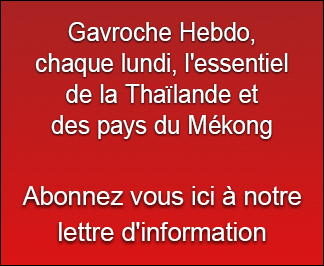Nous reproduisons ici une analyse du quotidien Nikkei
Prabowo Subianto a pris ses fonctions de président de l’Indonésie en octobre 2024 avec la promesse d’une croissance économique annuelle de 8 %, tirée par le développement industriel, des politiques sociales généreuses, un système fiscal renforcé et une augmentation des dépenses de défense. Moins d’un an plus tard, le pays est secoué par de violentes émeutes.
Les experts estiment qu’un changement de cap s’impose pour ce vétéran de 73 ans des intrigues politiques du pays. Selon eux, les programmes phares du président, tels que l’autosuffisance alimentaire, la construction de logements sociaux et la gratuité des repas scolaires, pourraient devoir être revus, alors même que le gouvernement a fortement réduit les dépenses dans d’autres domaines dans le cadre d’une vague de « mesures d’efficacité ».
L’économie pourrait également être plus faible que ne le suggèrent certains chiffres clés : les investissements directs étrangers dans le pays, par exemple, ont chuté de 7 % au deuxième trimestre, leur plus forte baisse en cinq ans. Pour les Indonésiens disposant d’un budget limité, les manifestations de générosité du gouvernement, comme les généreuses allocations de subsistance accordées aux parlementaires qui ont déclenché les premières manifestations, sont révoltantes.
Pour apaiser le mécontentement populaire, il faudra mettre en place des programmes qui « s’attaquent directement au coût de la vie », estime Siwage Dharma Negara, chercheur à l’ISEAS-Yusof Ishak Institute, basé à Singapour. « Les programmes de transferts monétaires et d’aide alimentaire doivent être élargis et affinés afin de garantir que cette aide parvienne réellement aux ménages à faibles revenus les plus touchés par l’inflation. »
En août, le prix moyen du riz, denrée de base en Indonésie, a augmenté de 6,2 % en glissement annuel et de 1,9 % en glissement mensuel, selon les nouvelles données de l’Agence centrale des statistiques indonésienne.
À la recherche d’une solution à plus long terme, d’autres ont appelé à une refonte plus radicale des dépenses publiques. Dans une déclaration commune publiée le 1 septembre, trois groupes de réflexion sur l’économie et les politiques publiques (CORE, INDEF et The Prakarsa) ont proposé de réduire le budget de la défense et d’augmenter les fonds alloués à la recherche et à l’éducation, ainsi que d’effectuer des transferts directs d’argent aux plus démunis, financés par la réaffectation des fonds destinés aux programmes présidentiels de repas scolaires gratuits et de coopératives rurales, ces derniers ayant été critiqués pour leur inefficacité.
Dans l’état actuel des choses, le projet de budget 2026 offre de nombreuses cibles tentantes. Le poste de dépense le plus important est le programme de repas scolaires gratuits, auquel ont été alloués jusqu’à 335 000 milliards de roupies (20,4 milliards de dollars), soit 8,8 % du budget total. Les dépenses de défense et de sécurité représentent 15,1 % du budget, dont la majeure partie est consacrée à la police et à l’armée. Une partie au moins de ces dépenses pourrait être réorientée vers la santé, l’éducation et la protection sociale, y compris les subventions pour les produits de base. Ces dépenses représentent actuellement 33,3 % du budget.
Lors d’une conférence de presse mardi 2 septembre, Deni Friawan, chercheur au Centre d’études stratégiques et internationales, un groupe de réflexion basé à Jakarta, a déclaré : « Il existe une crise de confiance envers le gouvernement en raison de l’effondrement de la légitimité fiscale. On demande aux citoyens de payer des impôts et des cotisations, tout en acceptant les mesures d’efficacité du gouvernement.
À première vue, l’économie indonésienne semble robuste. Une enquête gouvernementale publiée en juillet a montré que la pauvreté avait légèrement reculé de 0,1 point de pourcentage entre septembre 2024 et mars 2025, pour s’établir à 8,47 %. L’inflation en août s’est établie à 2,3 %. Et la croissance du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre a été de 5,1 %, une performance solide, même si elle est bien inférieure à l’objectif de 8 % fixé par Prabowo.
Mais en y regardant de plus près, des tendances inquiétantes apparaissent. Un rapport publié en juillet par Nomura souligne que les dépenses de consommation, qui représentent environ 55 % du PIB indonésien, « continuent de s’affaiblir ». Au deuxième trimestre, les ventes de voitures ont chuté en dessous de celles de la Malaisie, alors que cette dernière compte environ un huitième de la population indonésienne.
Certains s’interrogent sur l’exactitude des chiffres du PIB, à la lumière d’autres indicateurs économiques. « Nous n’avons pas beaucoup confiance dans ces données », a déclaré Capital Economics dans une note publiée après l’annonce du PIB.
D’autres nuages s’amoncellent à l’horizon. Malgré la conclusion d’un accord commercial avec les États-Unis, les exportations indonésiennes vers la première économie mondiale sont soumises à une taxe de 19 % dans le cadre du plan tarifaire « réciproque » radical du président Donald Trump, ce qui accentue la pression sur l’industrie manufacturière indonésienne. L’Indonésie a le malheur de bénéficier du taux tarifaire effectif le plus élevé de la région, reflétant les moyennes pondérées en fonction des échanges commerciaux, à 24,5 %, selon une étude de la banque singapourienne OCBC.
Pendant ce temps, Prabowo a supervisé une vaste réorganisation du gouvernement et des dépenses. Lorsqu’il a pris ses fonctions, il a créé 23 nouveaux ministères. Et fin janvier, il a ordonné des coupes brutales dans le budget 2025, d’un montant de 307 000 milliards de roupies, soit 8,5 % des dépenses prévues pour l’année.
Dans le même temps, selon l’Agence nationale de nutrition, 117 000 milliards de roupies ont été alloués au programme très médiatisé de repas scolaires gratuits pour 2025, et 79 100 milliards supplémentaires ont été réservés à la défense.
Les recettes publiques ont également été touchées. Les recettes fiscales ont baissé de 16,7 % à la mi-août par rapport à la même période l’année dernière, a déclaré un responsable du ministère des Finances à des journalistes locaux, tandis que les recettes non fiscales, qui devaient représenter 17,1 % des recettes publiques en 2025, ont également fortement diminué. Les bénéfices des entreprises publiques ont été détournés vers une nouvelle holding géante, Danantara. Et les redevances provenant d’industries telles que l’exploitation minière et les plantations ont diminué en raison de la chute des prix des matières premières.
Ces tendances sont étroitement liées. Un gestionnaire d’actifs basé à Jakarta a déclaré qu’il était « convaincu » que la réorganisation des dépenses publiques avait contribué à l’affaiblissement de l’économie au début de l’année.
Des problèmes ont entravé la mise en œuvre des politiques phares de Prabowo. Le programme de repas scolaires gratuits a été entaché par des rumeurs de chaos organisationnel et d’intoxications alimentaires. Et en août, un ministre a présenté ses excuses, admettant publiquement l’absence de progrès dans le programme gouvernemental visant à construire 3 millions de logements.
Cette situation survient alors que les gouvernements locaux ont adopté des mesures d’austérité en réponse à la réduction des transferts financiers de la part du gouvernement central. Beaucoup ont augmenté les impôts et réduit les dépenses. Même avant la récente vague de troubles, des émeutes ont éclaté dans deux villes en réponse à ces mesures et à l’arrogance perçue des politiciens locaux.
Armand Suparman, directeur exécutif du KPPOD, un groupe de réflexion axé sur les collectivités locales, a déclaré : « Si les dépenses d’infrastructure s’arrêtent, par exemple, cela a bien sûr un impact sur les fournisseurs locaux de sable, de pierre, etc. ».
L’emploi affiche également des tendances inquiétantes. Bien que le taux de chômage ne soit que de 5,5 %, Prabowo vantant le chiffre le plus bas depuis 1998, près de 60 % des personnes ayant un emploi travaillent dans le secteur informel, moins productif. Ces emplois, qui n’offrent aucun contrat, comprennent notamment les chauffeurs de taxi, les vendeurs de nourriture de rue et les petits agriculteurs. Cette année, le secteur manufacturier a connu une vague de licenciements qui a fait la une des journaux, notamment chez Sritex, une entreprise nationale emblématique spécialisée dans la fabrication de textiles et de vêtements.
Les troubles récents pourraient aggraver les préoccupations économiques de l’Indonésie. Selon une note de recherche publiée mardi par Capital Economics, l’impact immédiat sera modeste, mais pourrait peser sur le moral des consommateurs et des investisseurs.
À plus long terme, cependant, Capital Economics estime que ces troubles « renforceront les doutes quant à l’attractivité de l’Indonésie en tant que destination de délocalisation pour les multinationales à la recherche d’alternatives à la Chine ». Le Vietnam, grand gagnant de cette tendance jusqu’à présent, est considéré comme plus stable sur le plan politique.
Au cours de nombreuses conversations ces derniers mois, des personnalités du monde universitaire, des affaires et de la politique ont demandé de préserver leur anonymat lorsqu’elles critiquaient les politiques gouvernementales.
Certains affirment que les problèmes remontent à avant l’administration actuelle. Beaucoup de ceux qui ont vu les signes avant-coureurs ont hésité à tirer officiellement la sonnette d’alarme. « Le gouvernement indonésien dépense depuis longtemps plus que nécessaire pour la défense et la police, au lieu de réaffecter cet argent à l’éducation ou au bien-être de la population », a déclaré Esther Sri Astuti, directrice exécutive de l’Institut pour le développement économique et financier basé à Jakarta.
Si le gouvernement tente de réorganiser ses dépenses, les finances sont, à première vue, serrées. Le projet de budget 2026, publié en juillet, prévoit un déficit de 2,78 % du PIB, soit juste en dessous du plafond de 3 % que s’est imposé le gouvernement. Le dépassement de cette limite pourrait entraîner une réaction négative du marché.
Si certains indicateurs économiques restent préoccupants, la confiance des consommateurs s’est légèrement redressée en juillet. Il est possible de réaffecter les dépenses budgétisées, tandis que des liquidités hors bilan sont également disponibles.
Dans le passé, le président Prabowo a cédé à la pression pour modifier des politiques économiques impopulaires. En décembre 2024, il a de manière inattendue modifié une augmentation prévue de la TVA de 11 % à 12 %, en l’appliquant uniquement aux « produits de luxe », ce qui a contribué au déficit actuel des recettes fiscales.
Cependant, il pourrait être plus difficile pour Prabowo d’accepter de réévaluer ses propres programmes phares. Jusqu’à présent, le seul changement fiscal apporté à la suite des troubles semble être une exonération de TVA sur les chevaux et les équipements associés, pour l’armée.
Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici.