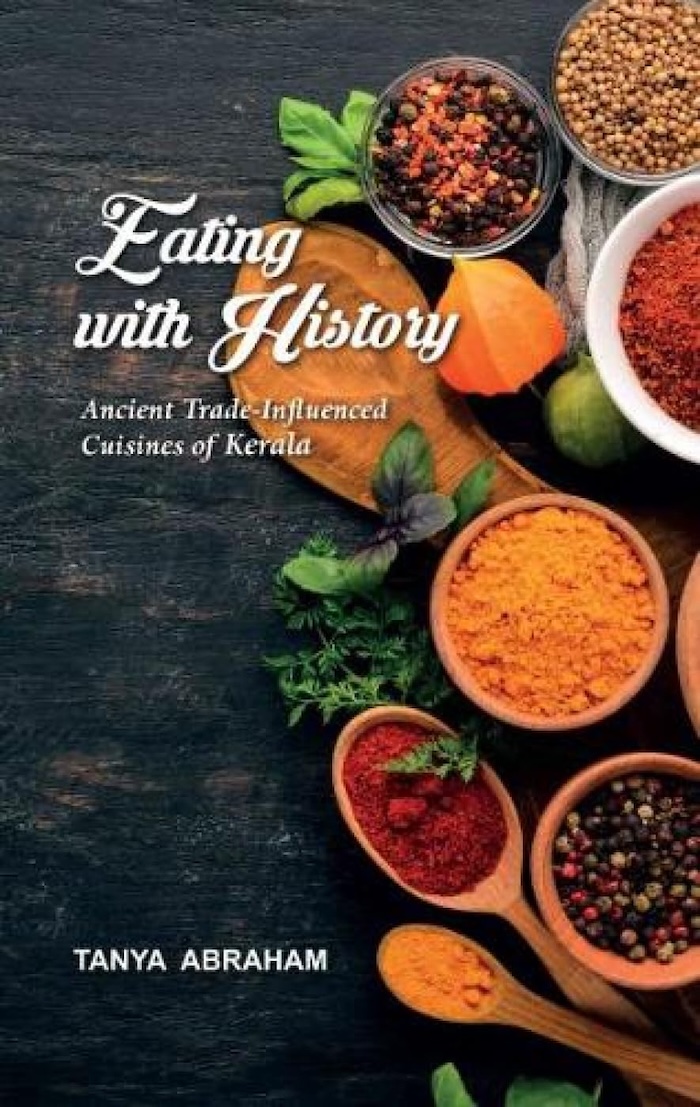
136 recettes du Kerela sous « influence étrangère », une chronique culinaire de François Guilbert
Le livre de Tanya Abraham est attrayant tant pour ses 136 recettes réparties en cinq chapitres (légumes ; pains, riz, appams et chutneys ; viandes et poissons ; bonbons et desserts ; boissons) que pour sa longue introduction historique. Un essai illustré de nombreuses photos d’archives familiales et des plats communautaires à concocter, identifiés d’ailleurs un à un par sous-ensembles (ex. anglo-indiens, chrétiens syriaques, juifs Paradesi et Malabari, Malabar Mappila, portugais). Une palette de goûts incroyables née de l’histoire, de l’agriculture locale, des échanges (inter)nationaux et de l’inventivité des groupes humains.
La cuisine du Kérala n’a jamais cessé de se nourrir d’influences « étrangères »
Adossé sur 600 kilomètres à la mer d’Arabie, l’État du Kérala a vu s’installer de nombreuses communautés commerçantes auxquelles se sont ajoutées au fil des conquêtes celles de puissances tutélaires successives (Portugal, Pays-Bas, Royaume Uni). De ce melting-pot humain est né l’une des cuisines les plus riches et singulières de l’Inde.
Par esprit d’exhaustivité, on regrettera néanmoins que la journaliste de Kochi ne se soit pas vraiment appesantie sur l’héritage gustatif néerlandais ; aussi limité fut il (ex. brudher (gâteau sucré aux prunes séchées), escalopes de pommes de terre). Par chauvinisme, dommage également qu’elle ait oublié dans son inventaire chronologique les apports français à la gastronomie locale. Qu’à cela ne tienne ! Pour pallier à ce dernier « manque », n’hésitez pas à vous en remettre à l’ouvrage de Sabitha Radhakrishna « Paachakam, heritage cuisine of Kerala » chroniqué dans les colonnes de Gavroche en mars 2024 (https://www.gavroche-thailande.com/livres/paachakam-heritage-cuisine-of-kerala/).
A vrai dire, les ajouts français n’ont été que quelques saveurs de plus à une vaste gamme gastronomique qui s’est élaborée à coups de rituels religieux transposés, d’ingrédients importés et d’adaptation des aliments locaux aux palais des nouveaux venus. Par bonheur, depuis le XVème siècle, la littérature des voyageurs et des administrateurs a permis de suivre avec moults détails, presque pas à pas, les enrichissements successifs de la culture culinaire du Kérala.
De nombreux apports ont été le fruit des stratégies matrimoniales des administrations coloniales
C’est particulièrement vrai des Portugais et des Britanniques. Bien qu’à trois siècles de distance, les pratiques des deux puissances européennes aient été diamétralement opposées. A partir de l’année 1510, les autorités portugaises incitèrent en effet leurs hommes à prendre pour épouses des autochtones, ce qui induisit un durable et profond mix-culturel et de la table (cf. pigadosi (bouillie sucrée de pâtes et de lait de coco), vindhalo (combinaison d’épices, de viande et de vinaigre)).
Un métissage prégnant jusque dans les assiettes d’aujourd’hui.
Cependant, des pans entiers de cet héritage sont méconnus voir oubliés (cf. l’introduction du vinaigre ou du piment rouge dans la cuisine indienne et le lait de coco dans celle des descendants lusitaniens). Il en est un peu de même avec celui apporté par les Nazaréens installés depuis le Ier siècle après Jésus Christ auquel l’autrice a donné dans ce manuscrit une grande place, notamment au travers de sa liste de recettes.
A l’inverse de Lisbonne, Londres à la fin du XIXème et au début du XXème siècles incita ses jeunes femmes à suivre leurs époux en Inde ou à y trouver des conjoints. Une politique familiale britanno-britannique qui bouleversa, en premier lieu, l’ordonnancement des cuisines huppées du Raj car il ne s’avéra pas si simple de créer des saveurs « anglaises » avec des produits « indiens ». A fortiori au Kérala, une région bien éloignée de Bombay et de Calcutta où parvenaient prioritairement les produits frais venus d’Europe.
Il n’en demeura pas moins que le tea time devint un rituel ; la nourriture « anglaise », sans même parler du whisky, des thèmes de conversations populaires et sociales ; et la recherche d’une cuisinière « sachante » (kokie), un sujet de préoccupation des maîtresses de maison. Une cuisine nouvelle vit ainsi le jour et à laquelle Tanya Abraham a su rendre un hommage justifié en retenant nombre de recettes pour en rendre compte au plus près.
La cuisine du Kérala doit beaucoup aux Européens mais également au Moyen-Orient
Si les patrimoines gastronomiques britanniques et portugais – la journaliste a dépeint ce dernier sous le vocable de « catholique latin » – ont largement charpenté les plats contemporains du Kérala, Tanya Abraham a tenu aussi à se pencher sur les nombreuses contributions culinaires amenées par les cultures arabo-musulmanes et juives.
A ce titre, la chroniqueuse s’est attachée avec attention à la place des femmes autochtones mariées à des Arabes (Mappila), leur système matriarcal et leurs coutumes culinaires particulières (ex. alisa (blé, poulet cuit dans du lait de coco et des épices entières), œufs durs et bananes sautées, poisson à la groseille à maquereau, viandes farcies, thé de Soliman). Plus encore, elle s’est intéressée à l’héritage des communautés juives séfarades (ex. ispethi (ragoût de bœuf rouge), mooli paratha (pain plat de blé fourré au radis épicé), pornas, la substitution des produits lactés par le lait de coco). Ce travail sur l’influence des communautés juives de Kochin, « blanches » (personnes venues d’Espagne et du Portugal au XVème et XVIème siècle) et « noires malabari » de Muziris telles qu’on les appelle sur place, est d’autant plus utile que le nombre de leurs membres s’est considérablement réduit depuis l’instauration de l’État d’Israël.
En compilant nombre de recettes des juifs malabars, l’ouvrage de Tanya Abraham fait œuvre utile et complète avec bonheur l’enquête minutieuse d’Esther David (Bene Appétit, The cuisine of Indian Jews) dont nous avons rendu compte en novembre 2024 ( https://www.gavroche-thailande.com/livres/bene-appetit-the-cuisine-of-indian-jews/).
Tanya Abraham : Eating with History. Ancient Trade-Influenced Cuisines of Kerala, Niyogi Books, New Delhi, 2022, 203 p, 20 €
François Guilbert
Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici.












